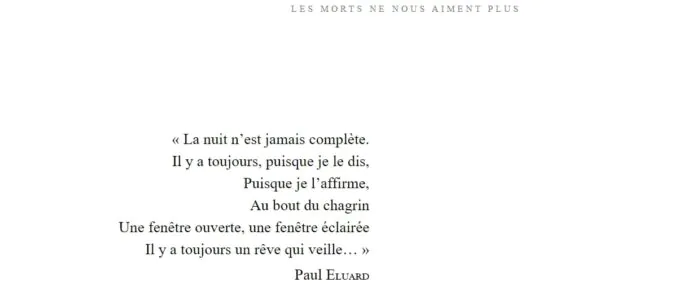Faire revivre les morts, est-ce de la science-fiction ? Il y a quelques années, une société japonaise a mis au point un logiciel informatique capable de faire réapparaître et revivre virtuellement les chers disparus et alléger, peut-être, l’épreuve du deuil. Microsoft s’intéresse aussi à un logiciel de ce type. Philippe Grimbert a réfléchi à la puissance de ces technologies qui donnent le vertige, et le frisson, dans un roman singulier, inquiétant et touchant à la fois, inspiré du mythe d’Orphée et de la toute récente série cinématographique « Black Mirror ».
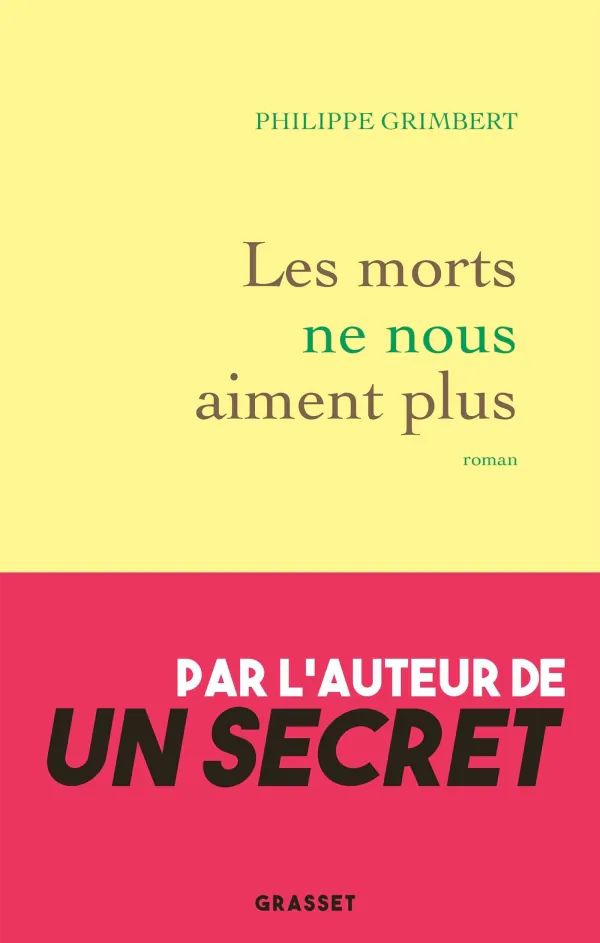
« Au fil des années mes écrits avaient fait de moi le spécialiste du deuil, réputation qui me valait invitations dans les congrès et interviews dans les médias. Mes romans et mes essais ne cessaient d’explorer ce thème, un choix qui n’était pas dû au hasard : Irène et moi avions passé notre vie en compagnie d’une armée de fantômes. »
Tels sont les premiers mots du livre, prononcés par Paul, écrivain et psychanalyste, frappé du deuil de ses deux parents, disparus ensemble, d’un accord et geste suicidaire communs « pour se faire sourds aux tambourinements de leurs disparus. » Irène, son épouse, a elle aussi perdu ses parents dans un accident automobile qui avait tout l’air d’une disparition volontaire. Le couple, enfin, est accablé de la mort d’un enfant « dont Irène a porté la promesse, jusqu’au jour où son enveloppe est devenue linceul. »
De ces malheurs sont nés des livres. Paul a écrit essais sur essais, comme « une jouissance de la plainte à laquelle nous avons su résister. » Irène, elle, écrivait des poèmes qui disaient « les infimes détails du quotidien » comme une résistance et un bouclier au malheur. Le couple écrivait et composait « à quatre mains » des pages qui avaient le pouvoir, illusoire, de tenir douleurs et menaces « à distance ». Mais peu à peu, le sentiment tragique de leurs vies reviendra, chez l’un et chez l’autre. Les poèmes d’Irène se nourriront peu à peu des fantômes du passé et ne seront plus qu’écriture du désastre. Quant à Paul, il ne trouvera bientôt plus ni énergie ni matière à se lancer dans de nouveaux essais. L’écriture qui le fuit serait-elle l’antichambre de sa propre disparition ?

La mort le frôle, en effet, en ce jour où une crise cardiaque le met à terre, sauvé de justesse par Irène qui l’entend tomber dans son bureau, à l’étage. Les secours promptement arrivés le ramènent à la vie. « Combien de temps suis-je mort ? » demande-t-il, étrangement, au médecin de l’hôpital : le cœur a flanché, « il s’est arrêté un moment » s’entend-il répondre. « Votre cœur ne peut plus se débrouiller seul, il va falloir l’aider avec ce petit appareil qui va réguler ses battements. Vous serez un homme bionique, un homme augmenté, en somme. […] Augmenté ? Moi qui me croyais diminué ! » Humour et politesse d’un désespoir annonciateur de la tragédie toute proche : son épouse Irène, reprise par le vertige de la douleur et de la mort de son père et de sa mère plusieurs années en arrière, « petite fille au regard triste et à l’enfance solitaire », inconsolée d’être orpheline et « tentée par l’abîme », va disparaître, elle aussi, volontairement, se tuant au volant, là même où ses parents avait précipité leur voiture dans un virage de la route des vacances. « L’amour qu’elle éprouvait pour son mari, pour sa fille (…) ne suffisait pas à lui donner la force de continuer.»
Après son accident cardiaque et « sourd à la détresse d’Irène », Paul n’avait rien vu du désespoir de sa femme, repris par son obstination d’écrivain et de conférencier. Et la mort de son épouse fera de lui le veuf, l’inconsolé. Le temps ne fera rien à l’affaire, tout lui rappellera Irène dans cette maison où plane l’ombre de la femme à jamais perdue, où il entend encore l’écho de la voix qui s’est tue : « Nous savons tous que les fantômes existent. Les morts qui nous hantent ne portent pas de suaires, ni de chaînes aux tintements lugubres, ils n’en réclament pas moins leur dû, nos chers disparus, ces spectres exigeants. […] La moindre de mes actions se ferait dorénavant dans son ombre et la femme de ma vie se pencherait toujours sur mon front pour y déposer un baiser, sa tête se poserait encore sur mon épaule lorsque nous écouterions l’une de nos œuvres préférées et son sourire perdu accompagnerait chacun de mes gestes. »
Lucian, un violoncelliste rencontré au concert et devenu son ami, veuf comme lui et « frère de douleur », survit à la perte de sa femme par la force de la musique et la beauté plaintive et grave des sonorités de son instrument. « S’il existait une consolation, elle vibrait au bout de ses doigts et accompagnait le mouvement de son archet. » Rien de tel chez Paul, qui s’enfonce alors « dans ce que Freud aurait appelé un deuil pathologique » et refuse que le deuil cicatrise une plaie que le temps achèverait de fermer. Tel Orphée veuf de son Eurydice, il voudra retrouver Irène, l’extraire des Enfers de la mort et du chagrin et « remplacer l’insupportable plus jamais par l’espoir de [la] retrouver dans l’au-delà. »
Un apprenti sorcier de l’informatique va lui en offrir l’occasion et lui proposera « le projet fou d’entrer en communication » et de dialoguer avec celle qui l’a quitté. À la condition, lui explique l’informaticien, que Paul lui parle d’Irène dans les moindres détails de sa personnalité : « Je crus entendre la consigne d’un psychanalyste me proposant un exercice d’association libre : Ne censurez rien, laissez venir ce qui s’impose à vous, sans écarter aucune pensée.» Paul, dans sa détresse, est prêt à tout, y compris céder aux artifices – et maléfices – du monde virtuel et de leurs nouveaux démiurges. « Et Irène serait dotée, m’avait-il affirmé, d’une intelligence artificielle alimentée par ses souvenirs, ses goûts, sa culture, pilotée par des algorithmes superpuissants qui feraient d’elle une créature vivante à part entière, libre de ses choix. Cette nouvelle donne avait quelque chose de vertigineux : mon cœur artificiel allait désormais battre pour une femme virtuelle. »
Irène, ou plutôt son avatar, apparaîtra, chaque soir, à heure fixe, sur l’ordinateur de Paul et tous les deux dialogueront, le virtuel suppléant alors complètement le réel…
Paul se laissera faire jusqu’à l’aveuglement et jusqu’à faire pleurer, un soir, la femme aimée, ou plutôt animée, à la simple écoute du Concerto en sol de Ravel, une de leur musique préférée : « Incapable de faire appel à la raison, je ne parvenais pas à me convaincre du caractère artificiel de la scène : ce n’était pas ma femme qui pleurait, il ne s’agissait que d’une image de synthèse dont les manifestations de chagrin obéissaient simplement aux paramètres d’un programme informatique.[…] Et lorsque mon ordinateur était éteint, mon téléphone portable prenait le relais. »
La folie guette alors le malheureux Paul, entraîné sur la pente fantasmatique et fatale de l’homme assujetti à la technique et aux « forces occultes qu’il a invoquées », sous la baguette de l’apprenti sorcier d’une technologie invasive et ravageuse près de lui faire perdre équilibre et raison. Au point qu’il songera même à user d’une forme de suicide « technologique » quand il apprendra que son cœur, aidé de l’artifice d’un pacemaker, peut être réglé à distance par le médecin à même d’agir sur la fréquence des battements cardiaques du patient et même… de les arrêter. Son médecin repoussera évidemment la demande suicidaire de Paul ! Mais il aura le bon réflexe de suggérer à l’écrivain le sujet d’un roman : « S’il est interdit au praticien de répondre à un tel souhait, aussi pathétique soit-il, rien ne s’y oppose au contraire pour le romancier ! Pas de limites à son imaginaire, aucune crainte de sanctions de l’Ordre des médecins ! Ne seriez-vous pas tenté de vous emparer d’un tel thème ? »
L’idée germera et préservera Paul : « Encore une fois j’avais frôlé une mort qui décidément ne voulait pas de moi. En choisissant de poursuivre mon chemin, ce ne serait qu’en renouant avec ce qui a toujours été ma raison de vivre : le bonheur d’écrire. »
Paul fera donc par l’écriture le pari et le choix de la vie. Par la grâce et le pouvoir des mots, la littérature se fera consolatrice et salvatrice. C’est la leçon de ce livre vibrant de détresse et de tendresse qui aurait pu s’intituler, comme Delphine Horvilleur l’a si bien dit : Comment vivre avec nos morts ?
Les morts ne nous aiment plus : roman, par Philippe Grimbert, Grasset, 5 mai 2021, 193 pages, ISBN 978-2-246-82864-8, prix : 18 euros.
Philippe Grimbert, né à Paris en 1948, est un écrivain et psychologue français.
Après des études de psychologie en 1968, Philippe Grimbert réalise une analyse d’orientation lacanienne, avant d’ouvrir son propre cabinet à Paris. Il travaille aussi dans deux instituts médico-éducatifs, à Asnières et à Colombes, auprès d’adolescents autistes ou psychotiques.
Passionné de musique, de danse et d’informatique, il publie plusieurs essais, dont Psychanalyse de la chanson (1996) et Pas de fumée sans Freud (1999). La Petite Robe de Paul, publié en 2001, le fait connaître en littérature générale. Il est en tout l’auteur de six romans, notamment d’Un secret (2004), vendu aujourd’hui à plus d’ 1 500 000 exemplaires, et récompensé par le prix Goncourt des lycéens en 2004, le prix des Lectrices de Elle et le prix Wizo en 2005. En 2007, ce roman est adapté au cinéma par Claude Miller, avec Patrick Bruel et Cécile de France dans les rôles principaux.
Plus récemment, il a publié La Mauvaise rencontre (2009), Un garçon singulier (2011), Nom de Dieu ! (2014) et Rudik, l’autre Noureev (2015).