En 2013, la (trop) discrète maison d’édition parisienne Sillage publiait une traduction, revue par Manfred Schenker, d’une des nombreuses nouvelles de Stefan Zweig, Le bouquiniste Mendel. Admirable texte qu’on peut lire comme un parfait reflet du style et une fidèle illustration de la pensée du grand écrivain autrichien. À tout lecteur encore ignorant ou peu familier de ce singulier et extraordinaire écrivain, voilà le petit livre qui vous convaincra à jamais de lire et relire régulièrement le grand polygraphe de Vienne.

Vienne, 1929, un homme d’une quarantaine d’année – Stefan Zweig peut-être ? – se promène dans la capitale autrichienne et, surpris par une averse, va se réfugier dans une brasserie. « Heureusement à Vienne, un café vous attend à chaque coin de rue, un de ces cabarets de faubourgs, dans la tradition viennoise, sans rien du clinquant moderne des cafés du centre, où l’on singe l’Allemagne ; il regorgeait de petites gens qui faisaient une plus grande consommation de journaux que de pâtisseries. » Eh oui, l’Autriche n’est pas l’Allemagne !
Ce café où il vient de pénétrer, rempli du brouillard tabagique de ses fidèles clients, lui procure alors une étrange sensation, un sentiment de déjà-vu, une vingtaine d’années plus tôt, à la manière de Proust cherchant à éclaircir la troublante sensation d’une madeleine trempée dans une tasse de thé. « J’étais déjà venu là, et là demeurait cachée et invisible, comme un clou dans le bois, un peu de mon âme d’autrefois, enfouie depuis longtemps. »
Une petite table carrée dans un angle du café lui révèle alors, en un subit éclair, le souvenir enfui du « bouquiniste Jakob Mendel, café Gluck, dans le haut de l’Alserstrasse », ce petit homme aux yeux cerclés de grossières et pauvres lunettes, penché sans fin sur ses catalogues de vieux livres, balançant le buste, comme il l’avait appris à l’école talmudique, pour mieux se concentrer sur la consultation de ses infinies listes de monographies anciennes. Cette prière-là était devenue celle du savoir bibliographique. Le « pauvre bouquiniste de Galicie », encyclopédie vivante et « catalogue universel ambulant », était cet homme capable de vous guider en un clin d’œil dans vos recherches universitaires sans l’ombre d’une hésitation ou d’une erreur, assis chaque jour à sa table de marbre gris sale, « autel des révélations bibliographiques » où venaient généreusement et pieusement enrichir leurs terrains d’études élèves et professeurs perdus dans d’infructueuses et dédaléennes recherches au milieu des fichiers et rayons de leurs habituelles bibliothèques d’instituts.

Et c’est bien ce qui était arrivé à notre homme il y a vingt ans quand il recherchait des livres anciens sur Mesmer et le magnétisme, dépourvu alors de bien des connaissances bibliographiques sur le sujet – lui, l’« amhorez », l’ignorant, comme l’avait alors qualifié Jakob Mendel, vieux Juif de Galicie. Il était donc venu consulter « l’oracle » lui aussi par l’entremise d’un ami et recueillir le savoir unique de ce « titan de la mémoire. »
Le petit homme, à la pauvre mise, « au corps contrefait, coiffé de papillotes, couvert de barbe et vêtu de noir », était venu de Russie jusqu’à Vienne une trentaine d’années auparavant pour y devenir rabbin, mais bien vite, il s’était détourné « de Jéhovah, le terrible Dieu unique, pour se vouer au riche et scintillant polythéisme des livres », une autre religion, celle de l’imprimé ancien, rare et précieux, qu’il détaillait, admirait et évaluait avec un sentiment du sacré, en une forme de cérémonie comme le « rituel de quelque liturgie, aussi ému qu’une jeune fille sentimentale à la vue d’une tubéreuse. » Le bonhomme Mendel était alors, du matin au soir, plongé dans son univers, celui des livres, « un monde supérieur au nôtre », il en était convaincu.

Comme chaque lecteur, venu le consulter en quête d’irremplaçables trouvailles bibliographiques devenait, aussi un consommateur, Jakob Mendel, ce « sublime monomaniaque », était vite devenu un allié précieux des affaires du café Gluck, nourri aux frais du patron. Sa table était « surveillée comme un sanctuaire. »
Mais qu’était-il donc devenu deux décennies après ? Personne dans ce café ne se souvenait de ce singulier personnage. Sauf, par chance Madame Sporschil, préposée à l’entretien et la propreté des lieux, à la fois méfiante de devoir rappeler le souvenir du vieil homme – « les gens du peuple pensent tout de suite à la police secrète quand on veut les interroger », ravie et émue de retrouver quelqu’un qui l’avait bien connu et se souciait de son sort.
Triste sort assurément, au moment où éclate la guerre, premier conflit mondial.
« Il ne s’était absolument pas rendu compte que c’était la guerre, lui qui n’ouvrait jamais le journal et ne parlait à personne. […] Sa seule joie, sa seule préoccupation, c’étaient les livres. »
Un jour, la police vint l’embarquer après avoir intercepté un de ses courriers envoyés à un libraire de Paris dans lequel l’innocent Jakob Mendel se plaignait… de ne plus recevoir les numéros du Bulletin bibliographique de France. Même scénario quelques semaines plus tard avec l’interception d’une lettre adressée à un libraire de Londres. Pour un motif à peu près identique. Deux lettres à destination de pays ennemis ! Cette fois, la police le soumet à un interrogatoire en règle : profession – « colporteur », lieu de naissance – « Petrikau, Pologne russe », nationalité – « russe, bien entendu. » Tout cela n’arrange pas les affaires du pauvre et naïf Mendel. Le bibliographe du café Gluck n’y comprend rien, « dans le mode supérieur des livres, il n’y avait ni guerre ni malentendu, seulement le savoir éternel et la soif d’apprendre toujours plus de mots, de dates, de titres et de noms. » Quant aux frontières, Jakob Mendel ignorait bien que « depuis 1914, elles étaient toutes cousues de barbelés. »
L’incompréhension et la colère montent alors chez notre malheureux bibliomane aux mains des policiers. Il s’agite, se débat, en perd ses lunettes qui se brisent à terre, « télescope magique qui le reliait au monde intellectuel. » Le pauvre homme est derechef embarqué « vers le camp de concentration des civils russes, près de Komorn. » Un camp où il restera deux ans jusqu’au moment où ses gardiens, intrigués de voir qu’on transmettait à ce pitoyable prisonnier des lettres envoyées par de hautes personnalités européennes, aristocrates ou intellectuels, toutes friandes de beaux livres et comptant au nombre de ses clients inquiets de ne plus avoir de ses nouvelles. C’est ce qui le sauvera.
Il sera libéré, mais sa liberté retrouvée sera bien sombre. Terriblement affaibli physiquement et moralement, il ne sera plus que l’ombre de lui-même. « Il y avait quelque chose d’irrémédiablement détruit dans son regard, l’horrible comète sanglante avait dû dans sa course folle percuter l’Alcyone paisible et solitaire de son univers livresque. » Et revenu – par habitude, par hébétude ? – à son cher café Gluck, le malheureux n’y recevra plus le même accueil. Ses connaissances bibliophiliques se sont enfuies, comme sa merveilleuse faculté de lecture, de mémoire et de concentration sur ses infinis catalogues. Le malheureux traînera alors guenilles et allures à faire peur et le nouveau patron des lieux finira par le chasser pour qu’il ne fasse plus tache dans son nouveau café remis au goût clinquant et luxueux de ces jours d’après-guerre. Le nouveau et profiteur maître des lieux chassera « la dernière trace importune de la misère des faubourgs de son café devenu cossu. »
Après avoir achevé son long et désolant récit fait à cet homme attaché à la figure du vieux Jakob Mendel, la malheureuse dame Sporshill se rappela qu’elle avait gardé en souvenir du vieil homme un livre abandonné sur la petite table de marbre par le bibliographe au moment d’être embarqué de force par la police. Elle remit ce livre, tremblante d’émotion, à ce bien cher visiteur, lui aussi bouleversé par le souvenir du vieil homme et par le geste de la dame du café Gluck. Jakob Mendel sera à jamais dans sa mémoire par cette relique, le dernier livre qu’il eut dans les mains avant son arrestation, un livre, objet fait « pour unir les hommes par-delà la mort et nous défendre ainsi contre les adversaires les plus implacables de toute vie : l’évanescence et l’oubli. »
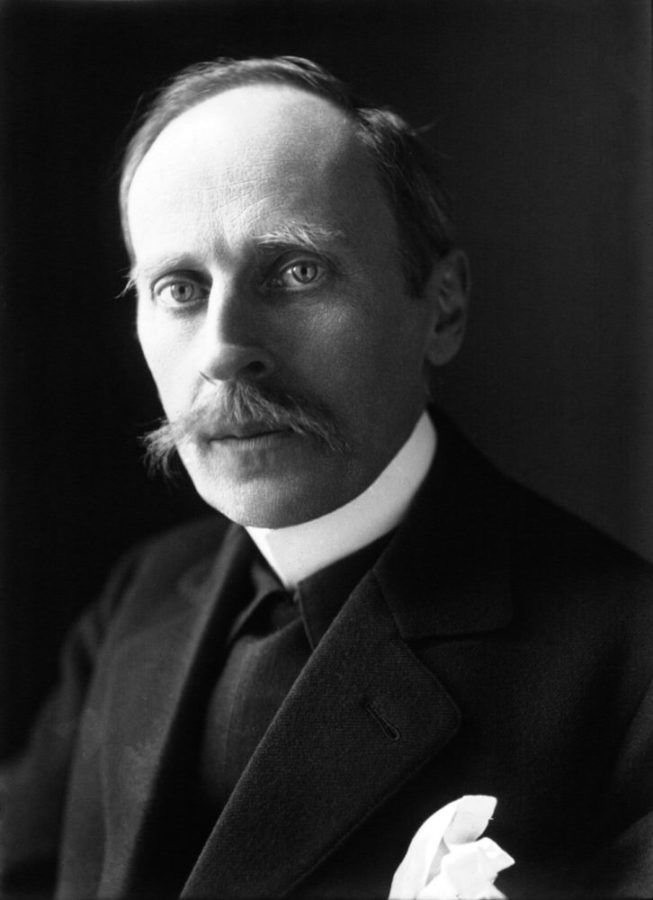
Ce texte, extrait de ces courtes nouvelles qu’aimait tant écrire Stefan Zweig, illustre et éclaire magnifiquement la pensée de l’écrivain autrichien et pourrait être la meilleure des approches pour qui ne connaîtrait pas ou peu le grand auteur de Vienne. Tout, dans cette courte prose, résume ses obsessions : son incompréhension des nationalismes et des guerres, son absolue vénération du monde du livre qui, seul, peut nous sauver du naufrage, pensera-t-il toujours, son obsession de rester en dehors de toute contingence et obligation politiques, d’être au-dessus de la mêlée pour reprendre des mots chers à son ami, et pacifiste, Romain Rolland. Il est vrai que, jusqu’à la veille de la guerre de 1914, son travail d’écrivain l’absorbait et ne laissait guère de place à une perception attentive des problèmes sociaux et politiques de son pays et de la métropole de Vienne. « J’ai appris à vivre ma vie indépendamment des événements, je me suis retiré dans ma peau de travail » écrira-t-il à Romain Rolland. « Nous autres jeunes gens, complètement enfermés dans le cocon de nos ambitions littéraires, n’avions presqu’aucune conscience des dangereuses mutations que connaissait notre patrie » écrit Zweig dans son autobiographique et testamentaire recueil « Le Monde d’hier ». Que fait d’autre en effet, à sa mesure, le solitaire Jakob Mendel ?

Le monde politique, dont Zweig voulait se tenir éloigné, va le rattraper avec l’avènement d’Adolf Hitler et sa mainmise sur l’Autriche. Il sera désormais en Allemagne et dans son propre pays « le Juif Zweig ». Comme son personnage est devenu « le Juif Jakob Mendel », interrogé, arrêté puis déporté dans un camp de concentration allemand. La censure et les autodafés viendront s’ajouter à l’effroi et à l’horreur de Stefan Zweig, spectateur des extrémités affichées et commises par le national-socialisme. Notre écrivain viennois va cruellement déchanter, jusqu’alors bercé, ou berné, par les mots de son éditeur allemand Insel : « Qui irait interdire vos livres ? Vous n’avez jamais écrit un mot contre l’Allemagne et ne vous êtes jamais mêlé de politique. » C’est pourtant ce qui va se produire. Son aura de grand intellectuel ne suffira plus. Et seul l’exil désormais pourra sauver « sa liberté intérieure », celle d’un Montaigne, qu’il aimait tant, le Bordelais « égaré dans une époque tout aussi terrible que la nôtre. » Dès lors, cet esprit libre sera celui d’un être en errance, un apatride. L’Europe déchirée s’est « cloisonnée, verrouillée, grillagée de frontière pour l’homme né libre. […] L’équilibre intérieur, en particulier chez nous les Juifs restera ébranlé pour toute notre vie ; nous sommes des anomalies vivantes, nous vivons et pensons dans une langue qu’on nous enlève, vivons dans un pays, dépendons du destin d’un pays auquel nous ne sommes pas vraiment liés et où l’on nous tolère tout juste, Juifs sans croyance religieuse et sans la volonté d’être juif. »

Stefan Zweig, désespéré du monde, et sa seconde épouse, Lotte Altmann, se donneront la mort en 1942, exilés au Brésil, dans les bras l’un de l’autre. Jakob Mendel, exclu de son univers, de ses irremplaçables livres et catalogues, mourra misérablement sur un trottoir de Vienne, chassé dans le froid de l’hiver, à la porte de son cher café Gluck : « Mendel n’était plus Mendel, comme le monde n’était plus le monde. »
Le bouquiniste Mendel de Stefan Zweig. Traduit de l’allemand par Manfred Schenke. Éditions Sillage Paris. 2013. 60 pages. Prix : 6.50 euros.
Autres livres de l’auteur dont sont extraites les citations de cet article :
Le monde d’hier de Stefan Zweig, traduit de l’allemand par Dominique Tassel. Éditions Gallimard, coll. Folio Essais (2013). 588 pages. ISBN 978-2-07-079219-1. Prix : 8.50 euros.
L’esprit européen en exil : essais, discours, entretiens, 1933-1942 de Stefan Zweig, éd. établie par Jacques Le Rider et Klemens Renoldner, traduction de Jacques Le Rider, Bartillat éditeur (2020). 415 pages. ISBN 978-2-84100-688-5. Prix : 22€.

