Dans un roman où la part d’autobiographie n’est pas complétement absente, Camille Laurens nous plonge dans l’atmosphère sociale et familiale de la fin des années cinquante en Normandie.
Fille nous fait voir la vie d’un couple bourgeois et aisé, dominé par un chef de famille autoritaire entouré d’une épouse réduite à n’être que femme au foyer au service de son médecin de mari et de leurs deux filles. Tableau de trois générations successives, le roman nous raconte l’enfance, l’adolescence et la vie adulte de l’une des filles, Laurence, confrontée à l’évolution de la société des années soixante, soixante-dix et quatre-vingt, en proie elle-même aux secousses d’une existence et d’une société qui s’éveillent à la condition féminine. Un beau roman d’apprentissage.
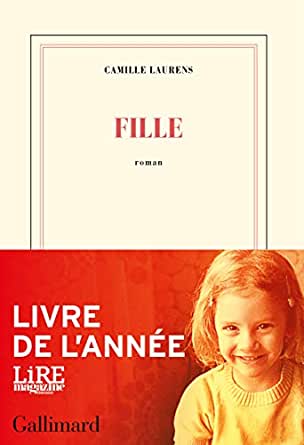
« C’est une fille » : ainsi débute le roman. Nous sommes à Rouen en 1959 – année de naissance de Camille Laurens à quelques mois près. Le constat est terrible pour le père de famille, Mathieu, médecin de son état, qui ne rêve que de succession mâle. Il avait même déjà pensé à un double prénom pour l’héritier qui arrivait, « Jean-Mathieu », accolant ainsi le prénom de son père et le sien propre. Espoir déçu, colère rentrée à peine dissimulée, à croire que son couple n’est que « faiseur de filles », la précédente naissance ayant joué la même partition avec l’arrivée de Claude. Le prénom choisi marquait déjà le vœu intime d’être père d’un garçon. Le deuxième enfant s’appellera Laurence. Un prénom masculin après tout chez les Anglais, se dit-il. Son confrère, le Dr Galliot, heureux père d’un petit Jérôme né le même jour à la clinique Sainte-Agathe, se hasardera : « Alors ? – C’est une fille – Ah ! C’est bien aussi. » Amertume et jalousie mêlées.
Pire, les filles se suivent – « Je suis une fille » dira plus tard la benjamine Laurence dans une troublante homophonie et polysémie de la langue française – et une nouvelle grossesse donnera naissance à Gaëlle. Nouvelle déception et un prénom ambivalent qui veut cacher une fois encore le dépit. La pauvre petite mourra quelques jours après la naissance sans même que son père daigne aller la voir. « Bref, Gaëlle, troisième fille, dernière sœur, n’est pas tombée dans le bon biotope. Personne n’en voulait, alors elle s’est éclipsée discrètement. » Cruelle indifférence d’un père obsédé par l’introuvable lignage masculin d’une famille rêvée. Les enquêteurs du recensement de 1964 qui demandent à Mathieu s’il a des enfants s’entendent répondre : « Non, j’ai deux filles. »

À la maison, deux psychologues scolaires viendront un jour interroger les parents sur l’orientation qu’ils souhaitent donner à leurs enfants. Le discours du père sur ses filles, et les filles en général, ne varie pas, même hors du cercle de famille : « Vous savez ce que c’est les filles, elles se chamaillent tout le temps, elles se tirent les cheveux. C’est des sacrés petites garces quand elles s’y mettent. » Pas un mot de la mère pour adoucir le propos, femme effacée et soumise. Les années 50 et 60 brident la parole des épouses, encore largement empêchées dans leur liberté de parole et leur indépendance économique. Sauf autorisation maritale.
Laurence retient le mot : « Garce. Le mot revient et la hante. C’est une injure. Mais n’est-ce pas d’abord le féminin de garçon ? Tout ce qui est féminin déçoit, déchoit, elle le sait désormais. Garçon, c’est un constat. Garce c’est un jugement. Le mot en changeant de genre devient mauvais. » Le vocabulaire lui aussi serait-il sexiste ? Quand on veut (se) donner du courage, « on dit : Sois un homme. On ne dit jamais : Soit une femme. » Et la syntaxe s’en mêle aussi, qui institue que le masculin doit toujours l’emporter sur le féminin.
Les mots et la grammaire ne sont, hélas, que l’un des signes visibles d’un iceberg social parfaitement inégalitaire. En famille, le père aime raconter que, le premier jour de son entrée à la faculté de médecine, « le professeur Gaubert, un grand ponte, ami de son père, avait commencé ainsi son discours : « Bonjour à tous. Vous entreprenez aujourd’hui un long chemin. La sélection est rude et je tiens à vous donner les dernières statistiques : seuls quatorze pour cent des étudiants présents dans cet amphithéâtre deviendront médecins. Mais je vous rassure, mesdemoiselles : avec de la persévérance plus de cinquante pour cent d’entre vous deviendront femmes de médecin. »
Laurence apprend vite et lit en même temps que sa sœur, à cinq ans. Les Contes d’Andersen sont sa pâture, qui la font pleurer. « Mais j’aime pleurer et personne ne me le reproche – les filles ont le droit. » Au cinéma, Blanche-Neige la fait rêver : « Un jour mon prince viendra, un jour on s’aimera. » Adolescente brûlant « de se conjuguer au féminin », l’amour est encore pour elle un mystère, comme les mots qui le portent et les gestes qui l’affichent. Au contact de sa grande sœur, elle apprend le baiser sur la bouche, les mots de l’amour et du sexe, surtout les mots interdits, cherchés dans les encyclopédies de la bibliothèque des parents. « Le mot sexe est à rapprocher du latin scare qui veut dire couper : ah voilà tout s’éclaire on a sexe-tionné le zizi des garçons pour en faire des filles. » Le sexe serait-il blessure ?
La peur aussi s’en mêle : « La domination vient des hommes. Tandis qu’une femme vit sans arrêt sous la menace, et très tôt dans sa vie. Toutes les femmes ont peur, c’est tout. […] Une femme menacée, c’est un pléonasme. » Le sexe, source d’angoisse ? Assurément, après cet épisode de la prime adolescence qui fera une plaie au cœur de la gamine de 9 ans : Laurence se retrouve à la campagne avec son grand-oncle, vieux fermier costaud, rustaud et saligaud, qui la colle contre ses cuisses et la caresse, sous les yeux de la famille qui sait mais n’intervient pas. Surtout ne rien dire et laisser faire, lui intime-t-on. Sidérée, elle subit la double peine d’une solitude irrémédiable et de la honte que recouvre le silence de ses proches.
En grandissant, les garçons portent sur elle et sur son corps des regards de concupiscence et d’avidité. L’apparition des règles auxquelles nul ne l’a préparée est aussi vécue avec stupeur. Au milieu de ces révolutions adolescentes, celles des corps et des relations entre filles et garçons, une question, sans vraie réponse, l’obsède : « C’est quoi, l’amour ?
De précoces et maladroites étreintes, qu’elle connaîtra dans les bras de Jérôme, le fils du dentiste, « son faux jumeau de la clinique Sainte-Agathe », devenu gaillard d’un mètre quatre-vingt-dix, l’entraînera vers un avortement opéré par un interne d’une clinique rouennaise qui tentera de la réconforter : «La douleur ressemble à celle de l’accouchement. Ce qui ne vous dit pas grand-chose, je sais. A moi non plus d’ailleurs. » Que tu donnes la vie ou que tu y renonces, c’est la même douleur, me dis-je sans étonnement. C’est une revendication de solitude. » Amour est-il blessure, une fois encore ?
Et puis l’amour, le vrai, va l’atteindre avec la rencontre de Christian, le futur mari. Avec lui, c’est la découverte du plaisir, « cette ivresse inquiète, cette ignorance instruite. » Cette union, de facto, la fait changer de nom, et de «fille de », la voilà pour l’état- civil « femme de ». Réduite à cette identité, contrainte de s’y conformer, elle est désormais « Laurence Charpentier […]. L’unique mot qui te désigne ne cesse jamais de souligner ton joug, il te rapporte toujours à quelqu’un – tes parents, ton époux -, alors qu’un homme existe en lui-même, c’est la langue qui le dit. »
La femme va devenir mère et vivre une tragédie, par la faute d’un géniteur toujours plus autoritaire qui la fait changer de gynécologue sous le faux prétexte que la spécialiste qui suit sa grossesse est « alcoolique ». Sous sa pression, elle est suivie, tardivement et contre son gré, par un jeune médecin ami de son père. Encore un homme ! Et c’est la tragédie: l’accouchement qui s’annonçait sans grands problèmes se passe mal et l’enfant –un garçon, qui plus est, baptisé Tristan – meurt à la naissance par l’impéritie de l’obstétricien. Pages terribles qui rappellent que Camille Laurens a elle-même connu ce drame dans un récit, « Philippe ». Le 7 février 1994 , elle met au monde un fils. Le lendemain, elle assiste à son enterrement. Philippe est mort deux heures après sa naissance par la négligence du médecin qui l’a accouché. « Il y a une chose infiniment plus douloureuse que de ne pas serrer dans ses bras un homme qu’on désire: c’est de bercer dans ses bras un bébé mort. Le corps ne comble rien. Le corps manque. » écrira alors la romancière. Et Laurence Charpentier revivra le même deuil, inconsolable. « Le rapport ne conclut pas à une faute médicale mais à une « perte de chance. » […] La perte de chance, ici et maintenant, c’est d’être quelqu’un qui ne choisit pas, qu’on manipule, le jouet d’un mensonge, l’enjeu d’un accord tacite, une personne dont le sort, la vie, le malheur et la joie se décident à côté d’elle, en dehors d’elle, malgré elle, chez les parents, les maîtres et les hommes. La perte de chance, tu vois, c’est d’être une fille. »
Et c’est une fille qui viendra au monde, Alice, après le petit Tristan. Avec l’angoisse d’un nouveau drame : « Je ne croyais plus à l’immortalité, j’étais devenue vieille. Quand un enfant meurt, il n’y a plus d’éternité. » Alice, heureusement, grandit bien. Et se prend pour un garçon, refuse robes et jupes, poupées et jouets de filles, s’amuse avec les garçons et affiche « d’exceptionnelles capacités en rugby », appréciation du prof de gym. Alice, un garçon manqué ? « On ne dit jamais ça, une fille manquée, vous avez remarqué ? ». Alice serait-elle le garçon disparu qui manque à jamais à Laurence ? « Un garçon manqué ? Non. Disons plutôt un garçon manquant. Alice veut vous redonner Tristan, c’est tout », diagnostic du psy.
Alice ne persistera pas dans son désir de vivre à l’égal de ses copains. Ses cheveux coupés courts, sa large carrure, ses muscles affermis, de moqueuses remarques des garçons eux-mêmes, achèveront de la lasser et elle finira par adopter robes et sandales à talons découvrant des « jambes de gazelle » et une silhouette de jeune fille, fierté de sa maman. Si la féminité reprend ses droits, la conviction d’un féminisme de combat aussi la gagne. « Les hommes ont peur pour leur honneur, tandis que les femmes c’est pour leur vie. » Un soir, Alice souhaite découcher du domicile, avouant à sa mère la nature de cette échappée d’une nuit. « Tu es amoureuse et tu veux rester dormir chez lui, c’est ça ? Il s’appelle comment ? » lui demande-t-elle, heureuse pour sa fille comme jamais.
Laissons au lecteur la surprise de la réponse d’une Alice irradiée du bonheur d’être « fille », le mot qui ouvre et achève ce livre lumineux, magnifiquement écrit et construit, peut-être le plus réussi de Camille Laurens, et assurément l’un des plus beaux romans de l’année 2020.

