Charles Sorel, Jean-Pierre Camus, Segrais, Saint-Réal, Boursault, Madame de Villedieu, voilà autant d’écrivains du XVIIe siècle français largement oubliés de nos manuels de littérature. Serait-ce parce que leurs récits sont souvent marqués du sceau d’une insondable cruauté humaine à faire fuir nombre de lecteurs ? Un volume de la collection de poche « Folio » paru il y a presque trente ans nous a offert maints exemples de cette très méconnue littérature du mal. Lecteurs sensibles, s’abstenir !
La littérature du XVIIe siècle français abonde en longs romans dont le plus ample fut L’Astrée d’Honoré d’Urfé, publié de 1607 à 1627 et le plus lu, La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. La mode est alors aux romans où de loyales épouses demeurent fidèles à de séduisants mais inconstants maris ou amants. Le court récit, ou nouvelle – dont Cervantès fut un inspirateur en deçà des Pyrénées avec ses Nouvelles exemplaires – fait son apparition dans la deuxième moitié du siècle. Et les chastes et sages inclinations de bergers et de bergères, de princesses et de chevaliers, cèdent alors le pas à la tragique noirceur de déchirants sentiments amoureux et de leurs cortèges de drames.
Après les longs romans sentimentaux et pastoraux, place, donc, à un réalisme implacable, cru et glaçant. Et dans le magasin des horreurs, certains romanciers français du XVIIe siècle ont une place de choix. Non que leur style fût relâché ou grossier, la langue utilisée étant au contraire des plus châtiées, toujours élégante et raffinée, voire précieuse, et digne de celle de la contemporaine Madame de Lafayette, pionnière du roman d’analyse. Mais Charles Sorel, Jean-Pierre Camus, Saint-Réal, Boursault ou Madame de Villedieu ont eu à cœur de raconter les pires vilénies de l’âme humaine et les épouvantables effets de la jalousie, de la cruauté et de la barbarie d’hommes et de femmes sous le joug du sentiment amoureux.

Le schéma fictionnel de leurs récits, les uns après les autres, ne varie guère : un tendre jouvenceau et une candide jeune fille, tous deux vierges et transis d’amour, tombent dans les bras l’un de l’autre, secrètement et illégitimement. Les sœurs, ou frères, en prennent ombrage, minés par la jalousie, « cette peste des cœurs ». Plus indignes encore, de cupides parents et d’antiques barbons se mêlent de l’affaire, et veulent, les uns, détourner leur progéniture de partis sans fortune, et les autres retrouver la fougue de leurs vingt ans et arracher les donzelles des bras de leurs jeunes amants. Dans tous les cas, c’est le pire qui arrive. Les rivaux jaloux brisent les couples par tous les moyens imaginables : dénonciation, empoisonnement, crime, rien ne les arrête ! Avant de subir eux-mêmes le châtiment (généralement divin) qui convient aux traîtres. Tel Philippe II, roi d’Espagne, dans le Dom Carlos de Saint-Réal, devenu veuf, se remariant avec celle qui était destinée à son fils et qui meurt « frappé d’un ulcère, qui engendra une quantité effroyable de poux, dont il fut dévoré tout vivant et étouffé ». Dans Le Cœur mangé de Jean-Pierre Camus – théologien et évêque à la plume prolifique qui occupait ses étés à écrire des romans noirs ! -, c’est Crisèle, demoiselle amoureuse du jeune Memnon, qui subit la loi de ses parents « aveuglés d’ambition et d’avarice » et se voit contrainte d’abandonner son amoureux sans le sou pour un « vieux gentilhomme des plus riches et autorisés de la contrée ». L’ancêtre fera assassiner le jeune fiancé et la jeune femme ira pleurer son chagrin, chaque jour que Dieu fait, sur le tombeau de son cher amant disparu. Ne supportant plus cette passion d’outre-tombe et cette « affection qui n’était due qu’à lui seul », le vieux fit dérober le cœur du défunt et « le fit hacher et mettre en pâte par son cuisinier avec d’autres viandes et de cette sorte le fit manger à Crisèle sans qu’elle y pensât. Il est vrai, comme il avait été embaumé, qu’elle disait en le mangeant que cette chair était parfumée, dont le jaloux vieillard se prenait à rire mais d’un rire sardonien ».

Dans La Mère Médée, du même Camus, la vengeance et l’horreur ne sont pas moindres. Safandin et Alfride, mari et femme, vivaient en bonne intelligence au Landgraviat de Hesse, belle province de l’Allemagne. Et leur union donna naissance à quatre enfants, « communs gages de leur fidélité, liant leurs cœurs aussi bien que leurs corps d’un nœud non moins agréable qu’honorable. » Élan réciproque jusqu’à ce que la mort ne sépare le couple ? Que nenni ! « L’amour, ce malheureux boutefeu qui saccage les réputations les plus éclatantes et ruine les meilleures familles, vint avec une pomme de discorde mettre celle-ci en combustion. […] Ce feu puant se fit assez tôt connaître à sa noire fumée, ce qui alluma l’esprit d’Alfride d’une si ardente jalousie qu’elle ne pouvait avoir de repos si elle ne trouvait moyen de satisfaire à sa vengeance. […] Un poète ancien parlant de la jalouse fureur de Médée dit qu’il n’y a ni vent, ni torrent, ni tourbillon, ni embrasement, ni orage qui se puisse comparer à une femme qui, méprisée de son mari, brûle en même temps d’amour et de haine, car cette double ardeur excite en son esprit des convulsions épouvantables. » Épouvantable, le mot n’est pas trop fort. Un jour, ayant envoyé tous les domestiques s’acquitter de diverses commissions, loin de la maison, elle se retrouva seule avec ses quatre enfants qui vont devenir alors les malheureuses victimes de la fureur criminelle et démente d’une mère trompée par un vil époux. Vision d’horreur d’un acharnement sans limites qui va faire passer de vie à trépas les quatre tout jeunes fils et filles, nés des entrailles de cette nouvelle Médée, par les moyens les plus barbares, « les taillant par morceaux » à coup de hache ! Ultime et satanique calcul : la criminelle s’entaillera le cou faisant accroire aux premiers témoins arrivés sur les lieux du forfait que le mari, à la réputation d’infidélité, en est le coupable, chacun étant « abreuvé du mauvais ménage qu’il faisait avec sa femme » ! La leçon était donnée à tous les maris que « la maison où règne l’adultère non seulement ne peut prospérer, mais est sujette à mille malheurs. »

Avec Le Prince de Condé, nouvelle d’Edmé Boursault, bourgeois lettré de la province champenoise, la narration, mélange d’histoire et de romanesque, nous fait revivre une époque fertile en événements dramatiques. L’intrigue, galante et bien ancrée en son siècle, se déroule à l’époque des Valois. Comme chez Madame de La Fayette. Mais cette fois, leurs médiocres acteurs n’ont d’autres sujets de conversation que maquillage, équipage et papotage, pataugeant du matin au soir dans de misérables marigots de fables et ragots, errant entre méchantes manigances et basses manœuvres. « L’unique chagrin qu’ils avaient venait de ce que tout le monde était couché, et de ce qu’ils étaient obligés d’attendre que le jour fût venu pour aller publier ce qu’ils savaient. » Aujourd’hui, ces fielleux personnages alimenteraient les médisances et rosseries véhiculées par les médias et la presse « people » ! Il faut dire qu’on s’ennuie ferme à la Cour, non des Valois mais, insidieusement masquée, de celle de Louis XIV. Et les sottises qu’on y raconte ne sont pas loin d’avoir été trouvées chez Saint-Simon – les pétards sous le cul de la princesse d’Harcourt par exemple ! Dans cette société de dépravante délation, on se cache sous les lits pour savoir qui couche avec qui. Et répandre illico la nouvelle dans les galeries du Palais !
Entre les deux pôles de l’horreur et de l’afféterie, notre insolite recueil de nouvelles d’un siècle pessimiste nous sert deux autres récits : Aronde, de Segrais – cet écrivain qui aida à l’élaboration de La Princesse de Clèves – et l’Histoire de Givry de Madame de Villedieu, qui nous réserve une fin lestée de deux cadavres, pas moins ! La leçon d’une telle débauche de vengeances et de morts, c’est Madame de Villedieu, prompte à nous offrir de ces mises en scène d’amours rageuses et assassines, qui en tire la leçon : « Ainsi finissent presque toutes les personnes qui s’abandonnent sans réserve à cette fatale manie. » Et notre nouvelliste achève de nous lancer quelques-uns de ses pessimistes vers : « Amour, cruel amour, enchantement des âmes / Hélas ! Ne verrons-nous jamais / Le funeste effet de tes flammes/ Respecter dans nos cœurs la sagesse et la paix ? »
Autant de parfaits exemples de ce que les « dixseptiémistes » nomment l’« anthropologie négative » du Grand Siècle, balayée par le vent d’optimisme philosophique du siècle suivant.
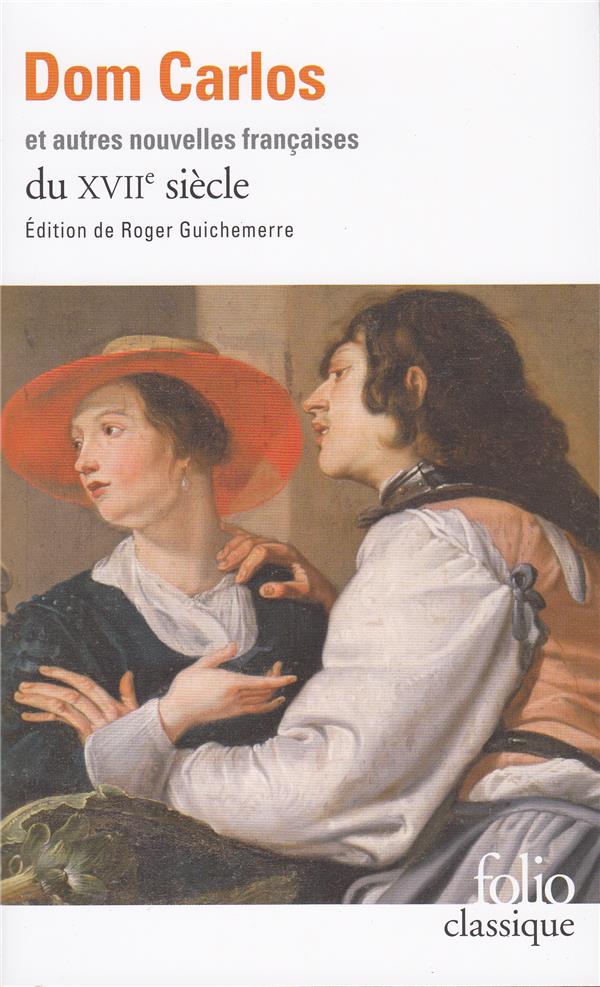
Dom Carlos et autres nouvelles françaises du XVIIe siècle, édition présentée, établie et annotée par Roger Guichemerre, Gallimard, 1995, coll. Folio, 457 p., 10,20€.

