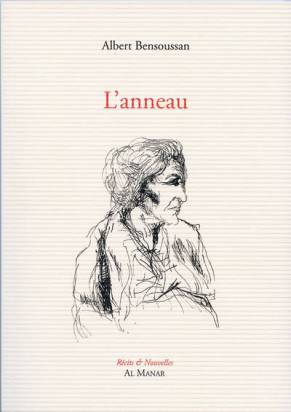Dans son récit L’Anneau, Albert Bensoussan nous donne les clés de son enfance, dans une langue somptueuse qui mêle saveurs, couleurs et odeurs d’un pays, l’Algérie, et d’une ville, Alger la blanche, à jamais paradis perdus. Éblouissant.
« L’Algérie au cœur ». Tel pourrait être le titre générique des écrits autobiographiques de cet universitaire rennais et « voix traduisante » de nombre des plus grands romanciers hispanophones contemporains, dont Mario Vargas Llosa, son ami de plus de quarante ans, nobélisé en 2010. Et comme ces autres textes parus précédemment chez le même éditeur, Aldjézar, Mes algériennes, ou Dans la véranda, le récit d’Albert Bensoussan, l’Anneau, publié en janvier 2017 par les éditions Al Manar, ressuscite la prime enfance et jeunesse de l’auteur en Algérie. Tous ces récits sont repris à l’infini, comme en boucle, à l’image du « kholkal », cet anneau de pied qui tintait et brillait à la cheville de la maman de l’auteur, fait d’un cuivre précieux comme l’or dans la mémoire enchantée de l’enfant.
Notre écrivain parcourt ce territoire et cette ville où il est né et a passé ses 26 premières années de vie (26, chiffre divin dans le Talmud…). Comme « l’arbre n’est rien hors d’une terre natale » (Yves Prié), Albert Bensoussan puise sa force dans le terreau de cette Algérie racinaire et nous livre un récit tourbillonnant et « kaléidoscopique » dans lequel vont renaître et s’entremêler les êtres qui l’ont construit : le père, Samuel, héros de la Somme, blessé par un obus en 1915, « si digne, si beau, si reître sur son haut cheval blanc », soigné pendant trois ans à l’hôpital militaire de Rennes par des infirmières dont il gardera à jamais un tendre souvenir, Aïcha, la fiancée, qui l’attendra sept longues années (sept, comme plus tard, le nombre de leurs enfants) et le retour à la paix pour l’épouser, Lalla Sultana, la grand-mère qui ne parlait que l’arabe dans les collines de Tlemcen, « la perle du Maghreb », son époux Messaoud, touchant vendeur d’épices, qui fermait sa boutique pour parler plus tranquillement avec ses clients, Alfred, filleul de Messaoud, qui précéda d’une année au tombeau Aïcha, la maman nonagénaire qui l’adorait plus que tous ses autres enfants et n’en sut jamais rien, protégée par le silence de la fratrie des frères et sœurs d’Albert.

Aïcha est la figure centrale et tutélaire de cette vaste famille – un « dédale cousinal » écrit Albert Bensoussan -, l’alpha et l’oméga de la mémoire de l’écrivain sur laquelle s’ouvre et se referme – l’anneau, toujours…- ce récit matriciel. Les femmes, de toutes les générations, de toutes les expressions, juives, arabes, berbères, qui composaient alors la « vivifiante Algérie », dominent les récits d’Albert Bensoussan. Depuis l’enfance et les premières amours adolescentes, réelles ou fantasmées, dont Fatiha, la « mora », la jeune mauresque « aux yeux gris et célestes » qui enflamme la mémoire d’Albert avec les accents du Cantique des Cantiques : « Je t’aimais pour ton teint de figue sombre et ta pulpe de fève. Tu n’avais pas l’odeur des miens, de mes sœurs, un miel d’aloès jaillissait de tes seins. L’agave peuplait ton aisselle. L’âcre musc de tes reins me soulevait d’ardeur ». Plus tard, beaucoup plus tard, Albert rencontrera Matilda Tubau, femme magnifique et solaire, venue de Catalogne, qui devint son épouse, pour un long temps, jusqu’à sa mort, en 2012 : « Matilda, comment l’oublier ! ». Déborah, son soutien dans le deuil, devint la seconde femme essentielle de sa vie.
Cette enchanteresse et enivrante poésie du verbe, ce carrefour des mots et des cultures qui parcourent sans cesse le récit de cette Algérie « d‘avant », éclairent aussi la mémoire d’une ville qu’Albert Bensoussan nous dépeint à la manière d’un peintre fauve. Alger était alors palette de senteurs, de teintes et de goûts : « À ses odeurs s’accordaient les couleurs, le rouge du piment, le blanc des anis, le vert des absinthes, le gris du poivre, les roses plus vives qu’aux jardins babyloniens, les jasmins si délicats qu’on les glissait aux narines ». Des couleurs et des odeurs exacerbées au marché Randon ou de Chartres, dans le cœur grouillant et bruyant de la ville, où s’offraient en abondance le pain tressé des juifs, les semouleux mekrouds des arabes, comme les zlabiyas dégoulinant de miel ou les galbelouzes à la fleur d’oranger, tous ces mets, tous ces mots, goulûment roulés dans la bouche.
Après novembre 1954 et « le meurtre primordial d’un couple d’instituteurs dans les Aurès, […] le rideau tombe sur l’Algérie heureuse ». Les navires rapatrieront, en 1962, les familles de pieds-noirs, qui ne furent pas toutes bien accueillies dans cette France, « mère des arts », chantée par du Bellay que le tout jeune Albert avait découvert, ébloui, dans la classe de 3è de Georges Sallet, son jeune professeur de français du lycée Gautier.

Albert Bensoussan, revenu en 1982 sur les terres algéroises, se sentira inconsolable orphelin de sa ville d’enfance, n’y retrouvant plus, même, la sépulture de ses ancêtres dans le cimetière juif d’Alger, ruiné par l’indifférence et le temps. « Nous fûmes indigènes sur cette terre algérienne qui, à l’Indépendance, nous fut refusée, mais nos traditions judéo-arabes, nos goûts berbères, la musique, la cuisine et les you-you, personne ne pourra m’en déposséder. […] Rien ne résiste au temps…sauf la mémoire ».
Ce livre, porté par la poésie infinie du souvenir et la tendre et profonde nostalgie d’un paradis perdu, est tout simplement magnifique.