Il ne faut lire de façon dénué de sens aucun vers en général : il en résulte une sorte de dérision préméditée de l’attraction éternelle des hommes pour la sagesse. (Zinziver, p. 297)
L’homme qui parle ainsi est le héros de Zinziver(1), Dimitri Slezkine. C’est un poète. Zinziver est le conte naïf, drolatique et terriblement perspicace de la vie haletante et tragi-comique de ce « travailleur littéraire » et de sa traversée épique du dégel du glacis soviétique. D’une absurdité l’autre, de la bureaucratie folle aussi formaliste que laxiste au business décomplexé, sauvage, à l’assurance un peu grotesque et tapageuse.
Zinziver est un roman-phénomène. Sans doute parce que Slipentchouk(2) y a fait, comme le dit Gérard Conio « un remarquable travail de mémoire » et qu’il y a rendu « aux derniers témoins d’une grande et tragique histoire », dans un style naturel et chantant « les odeurs, les saveurs, les bizarreries, les incongruités, les expressions, les clichés, les rites, les conventions, les idiosyncrasies d’une vie mutilée et qui recelait pourtant des sources de poésie et de joie dans la précarité même… » (Préface, p. 8).
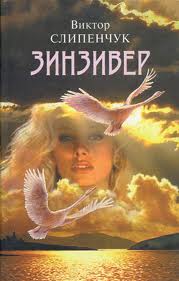 Paru à Moscou en 2000 et réédité dès 2001, il est traduit en ukrainien et en chinois, il est adapté au théâtre sous le titre Un roman sans didascalie et ne quitte pas l’affiche ne 2006 à 2009. Il est encore aujourd’hui au programme des études supérieures de russe en Chine !
Paru à Moscou en 2000 et réédité dès 2001, il est traduit en ukrainien et en chinois, il est adapté au théâtre sous le titre Un roman sans didascalie et ne quitte pas l’affiche ne 2006 à 2009. Il est encore aujourd’hui au programme des études supérieures de russe en Chine !
Quel monde étonnant ! Beau et contradictoire. (p.309)
Tel est le cri de la stupeur amoureuse de Mitia Slezkine ! Il lui aura fallu traverser bien des péripéties toutes plus rocambolesques les unes que les autres pour devenir, enfin, en transperçant le chagrin et le gris des choses, ce qu’il est : un poète. La constante de son existence se sera Rozotchka, sa rose, son unique. Leur union passera par le feu de la dissolution comme le pays dans lequel ils s’étreignent, se détache et se rattrapent pour se perdre à jamais, à toujours.
Les paroles maudites des poètes ne me sont pas données, elle a réduit à zéro toute l’éloquence du monde. Qu’elle femme c’était. (p.79)
Roman d’amour au sens quasi médiéval du terme, épopée claudicante et ébouriffante d’un fol amour, Zinziver c’est aussi une course, haletante, à bout de souffle. Avec ses pauses aux bouffées délirantes, ses élans mystiques au milieu de personnages aussi navrants qu’enivrants, hystériques et apathiques à la fois, chatoyants et désespérants.
Pour Mitia le culte chevaleresque de la femme aimée est indissolublement lié à sa création poétique et la trame de ses rapports avec Rozotchka reprend tous les poncifs de l’amour courtois, comme si la jeune fille était l’incarnation de la rose mystique chantée aussi bien par les troubadours du Moyen-Age que par les bardes romantiques. Et le contraste entre cette adoration et la « poschlost » (laideur, vulgarité) ambiante correspond à la dualité entre les idées et les faits, entre les nobles aspirations et la triste réalité qui a été la marque de fabrique de l’idéologie soviétique, une dialectique sans résolution, un problème sans solution, une machine désirante appelée à tourner sans fin sur elle-même en ne créant que du vide. (G.Conio, Préface, p. 10)
Dimitri Slezkine, 24 ans, son diplôme de « travailleur littéraire » en poche est « bien installé » dans son emploi de province « consultant littéraire dans le journal régional des jeunes Komsomols ». Mais il y a son amour Rozotchka :
Bien entendu, mon salaire était insuffisant, mais il est bien vrai qu’avec sa bien-aimée, même une hutte devient un paradis… Oh ! Nous avions une vie épatante ! Rozotchka dormait des journées entières et moi j’écrivais et j’écrivais… (p.33)
Tant bien que mal Mitia se démène, l’argent et la nourriture deviennent (avec la poésie) les absolues préoccupations quotidiennes. Tout cela, avec les gênes occasionnées, tous les mensonges, toutes les fuites notre poète le vit et le conte avec une légèreté sans faille dans laquelle se fond et coule l’amour total par lequel et pour lequel il vit, respire, marche, dort, boit, mange. Et puis l’argent allait venir, il allait se glisser dans ses poches tout seul parce que dans un tel pays qui a eu et qui a tant d’amour pour les poètes il ne pouvait en être autrement…
Puis se sera la fuite de l’unique. Un séisme pour Mitia. Le déclenchement alors de la mécanique folle d’un opéra-bouffe qui se joue de tous et qui inverse tout. Après la faim, la maladie, le souffle froid et fétide de la folie par des ressorts qui seraient absolument absurdes et invraisemblables partout ailleurs et dans un autre temps, Mitia se retrouve coqueluche de nouveaux riches, « un poète à la Fabergé » (p. 357). Oui, même ceux-là qui mettent l’ordre du pays sens dessus dessous aiment encore follement les poètes. Alors commence la quête éperdue, splendide et pathétique. S’y mélangent avec une allégresse teintée de nostalgie l’imaginaire poétique de Mitia et la réalité scabreuse d’un délabrement sans nom. Mais un nom le poète s’en fait un. Renommée, amour, argent, luxe. Les affaires sont frauduleuses, crapuleuses, forcément. Le regard du poète est poésie et tout ça c’est pour Rozotchka que ronge la maladie comme la folie de l’argent qui a pris le poète dévore leur pays.
Réjouissant et crépusculaire, Zinziver s’avère un texte splendide grâce au regard candide du narrateur dont tous les mots, même au cœur du malheur le plus insoutenable, sont baignés de l’humble et limpide certitude d’un cœur purement amoureux. Slipentchouk nous plonge au cœur du poète en même temps qu’au centre d’un temps et d’un pays bien réel. Réussite singulière ces deux univers ne s’affrontent pas, ils rayonnent ensemble.
Il y a quelques années mon collègue Francis Conte organisait à la Sorbonne un colloque destiné à répondre à cette interrogation : l’URSS est-elle un paradis perdu ? Le roman de Victor Slipentchouk donne une réponse nuancée à cette question, car il porte sur ce monde disparu non le regard critique d’un historien, mais le regard sensible d’un poète qui s’attache au vécu des événements plutôt qu’aux événements eux-mêmes. Aujourd’hui, dans les centres de recherches, dans les séminaires, dans les colloques, on multiplie les études et les statistiques sur tous les aspects, toutes les périodes du système communiste que l’on découpe en tranches. Ce sont des dissections pratiquées sur un cadavre que seule la fiction romanesque et poétique est à même de rendre à la vie. Zinziver confirme une fois de plus le pouvoir de transmission de la littérature qui réussite à faire passer par les sens, par la peau une atmosphère, l’air que l’on respire. (Gérard Conio, Préface, p. 15)
« Confirme une fois de plus », oui. Mais d’une manière remarquablement unique !
Victor Slipentchouk, Zinziver, L’Age d’Homme, Lausanne, 2012 (traduit du Russe et préfacé par Gérard Conio avec la collaboration de Nathalie Thauvin), 296 p. 29€
(1) Zinziver désigne un petit oiseau qui habite près des rivières. C’est également le titre d’un poème, ou plus exactement d’une « création verbale » (slovotvortchestvo) de Vélimir Khlebnikov (1885-1922) génie et martyr russe de la poésie auquel Slipentchouk se réfère expressément avec le choix de ce titre, mais également avec l’épitaphe qui ouvre le roman « Avec un battement de plume pour tirer des lettres d’or des veines les plus fines ». V. Khlebnikov. D’ailleurs le mot zinziver ne se trouve pas dans les dictionnaires russes académiques, mais renvoie plus spécifiquement « à cette couche clandestine et nourricière du langage qui rattache l’homme à la nature. » (G. Conio, Préface, p. 12)
(2) V. Slipentchouk est né le 22 septembre 1941 à Tchernigova. Après avoir été successivement géologue, ouvrier, zoo-technicien, marin, pisciculteur, constructeur et journaliste il entre en 1982 à l’Union des écrivains soviétiques et se consacré dès lors à la seule écriture.
« Comme Mitia, Victor Slipentchouk est poète et il est frappant de constater, quand on lit sa biographie, que la poésie a été la grande constante de sa vie nomade, l’axe, la colonne vertébrale qui lui a permis de constituer son identité par les mots, par le « verbe », le « slovo » qui, comme l’a écrit Mandelstam, a toujours été la seule vraie patrie de l’homme russe » (G. Conio, Préface, p. 11)







