William Navarrete fugue chez Stock. Né à Cuba en 1968, ce journaliste réside entre Paris et Nice depuis plus de vingt ans et collabore avec divers médias, dont El Nuevo Herald de Miami. Il a écrit plus d’une douzaine de livres d’art, de poésie et d’essais. Son premier roman, La danse des millions, a été publié chez Stock en 2012.
Ce n’est pas le paradis perdu, c’est le temps avec ses révolutions.
Les concours de beauté avaient été interdits, car ils représentaient la décadence bourgeoise. Le défilé de chars avait heureusement survécu. Un tracteur recouvert de papier brillant tirait une plateforme à plusieurs niveaux sur laquelle se déhanchaient des femmes presque nues, couvertes de plumes placées là où il n’y avait plus rien à cacher. Avec le défilé, le bruit atteignait son paroxysme, car les orchestres étaient également juchés sur les chars et chacun interprétait ses propres refrains.
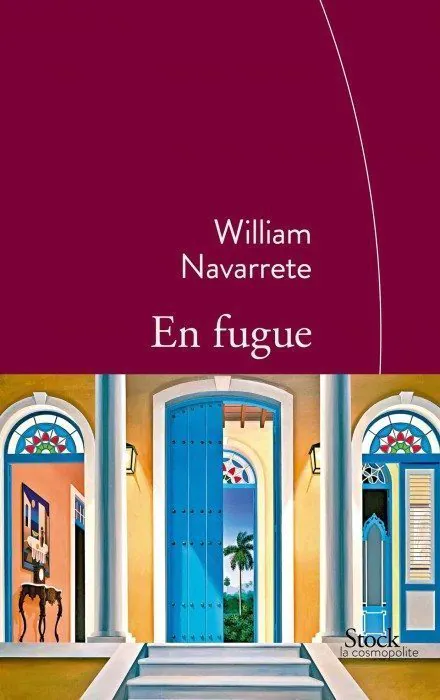 En fugue de Navarrete raconte l’histoire d’une mère et de son jeune fils destinés à prendre le chemin de l’exil. On les voit et on les observe tout au long du livre quitter leur province natale de Cuba, berceau indigne des derniers dictateurs pour la Havane. C’est une première fugue avant le grand exil. Il y en aura au moins deux.
En fugue de Navarrete raconte l’histoire d’une mère et de son jeune fils destinés à prendre le chemin de l’exil. On les voit et on les observe tout au long du livre quitter leur province natale de Cuba, berceau indigne des derniers dictateurs pour la Havane. C’est une première fugue avant le grand exil. Il y en aura au moins deux.
À distance, à flux tendu, le narrateur replonge dans l’histoire décousue de sa famille, de son île corrompue et irrationnelle. Quelle histoire tragique ! Sans nostalgie pourtant, il en restitue toutes les saveurs et les contrastes au rythme endiablé de la musique cubaine.
Quand il raconte, le jeune homme parle beaucoup de lui-même, et dans son parcours, s’ajoutent ces parties fictionnelles nécessaires empruntées aux personnages rencontrés tout au long de sa vie. La mère – sa mère, même s’il ne s’agit pas tout à fait d’une autofiction – est une « résistante » du quotidien. La vraie, celle qui est si proche du personnage, avec laquelle on la confond, est une de ces femmes du pays, qui ont réussi à survivre dans la nasse, liguées entre elles contre la masculinité du pouvoir dans laquelle les hommes imposaient les us et les coutumes. À l’image du dictateur, le récit exprime bien combien les hommes dictaient les attitudes, ainsi que cette impossibilité pour les femmes d’exprimer leur féminité, leur sensualité, leur sensibilité. Le roman souligne bien cet appauvrissement de la chair, de l’esthétisme.
Les femmes, résistantes donc, contre l’absurdité du quotidien, contre la langueur, ne se laissant pas vampiriser par la gangue du temps. Comme cette mère qui attendait une demi-journée pour prendre le bus. Les images du livre expriment un totalitarisme moscovite.
Et puis, à l’époque du narrateur, c’était toute une économie plongée dans le noir, asservie par des calculs machiavéliques, qui profitaient de la population occupée à ses petites tâches quotidiennes, et qui n’avait pas le temps de penser à autre chose.

En fugue parce que cela est immédiatement associé à l’adolescence : il n’est pas faux de voir dans ce choix du titre une dimension philosophique, mais également musicale. À rapprocher des pièces pianistiques jouées avec nombre de modulations, de mouvements prompts. En fugue pour dire, en effet, toute la magie particulière de Cuba, sa lumière, ses éclats, sa quintessence, son effervescente, ses couleurs. En fugue, parce que c’est ce qu’il convient le mieux depuis l’espagnol –langue originelle de l’écrit -, et qu’il est difficile de traduire autrement et plus longuement de manière patiente et appliquée.
En fugue raconte deux fugues correspondant à deux départs dont l’un peut être perçu et considéré comme un appel d’air. Un désir immense de liberté.
Il y a d’abord le départ de la mère et de son fils : l’enfant quitte la terre de son enfance, il délaisse l’enfance et ses rêves, il se dépouille de ses illusions (utopies) qui l’éloignaient de la réalité et de ses projections. L’écriture de l’auteur est alors onirique. La seconde fugue est la grande fugue lorsque les deux protagonistes quittent enfin l’île : et le fils s’éloigne alors définitivement du pays de son adolescence, et puis de la danse, de la culture, il cherche un Ailleurs, une liberté qui ne lui est pas encore acquise, dans ce pays bloqué, où tout acte est bafoué. L’écriture est plus sèche, plus drue lorsqu’elle mentionne ce pays scindé en deux, les absents, les Cubains du Nord, qui eux aussi, fuyaient l’interdit.
La place à quelques mètres. Les carrefours vomissaient des milliers de personnes vers cet espace démesuré. Quel horrible endroit. L’architecture du Troisième Reich, conçue à l’époque de Batista, peut-être dans le but d’intimider la foule. Ceux qui étaient en ce moment à la tribune en profitaient bien ! L’esplanade bourrée à craquer. Le pire était de supporter un de ces discours interminables de l’innommable au milieu de cette foule. On entendait déjà ses premiers hurlements. Il n’y avait pas d’autre mot pour ces vociférations. Dommage qu’on ne fût pas sourds. Ils sortaient des haut-parleurs, tourbillonnaient autour de la masse compacte, silencieuse et insoumise.
D’une voix haletante, le livre, au style parfait, excellemment bien écrit, met en lumière les différences entre tous les milieux sociaux, d’où le nombre incroyable de personnages et de représentations, notamment celle portant sur l’homosexualité – qui est un des thèmes majeurs du livre – , où l’allégorie amoureuse dépeinte semble sauver de l’adolescence. Avec autant de désir pour une contrée « perdue » que de regrets exprimés à l’égard des autres cubains, le roman résonne comme un adieu. On sent sous cette plume fertile un peu de tristesse, de la douleur et de la froideur : sans doute fallût il prendre de la distance pour raconter ce Cuba des années 60/70/80. (Navarette vit à Paris depuis 1991).
Dans l’absolu, c’est un livre très dense qui condense plusieurs générations de Cubains, et les familles de toutes les provinces du nord ou du sud de l’île que le narrateur renvoie dos à dos. La perception singulière des deux familles –père et mère –du narrateur, qui sont issus de milieux différents, permet des juxtapositions intéressantes. Des scènes symboliques émergent des métaphores fameuses. Très bon roman sur la fin du prestige de Cuba et de la vie contemporaine qui y régnait. Au siècle dernier.








