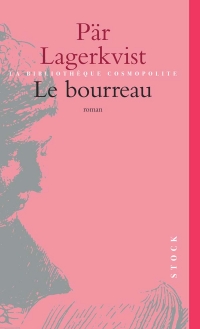Pär Lagerkvist est né en 1891 à Växjo, petite ville du sud de la Suède. Il est mort en 1974. Il a reçu le Prix Nobel de littérature en 1951.
Depuis quelques années, même s’il ne devient pas encore difficile de trouver dans les librairies les principaux romans de Pär Lagerkvist (Le Nain, Le Bourreau mais aussi La mort d’Ahasverus, Barabbas ou La Sybille), bien peu d’études me paraissent être consacrées à cet auteur qui reçut le Prix Nobel de littérature en 1951. Je profite de la parution d’un recueil de poèmes somptueux, où chaque vers résonne d’une douloureuse inquiétude métaphysique (par exemple, p. 63 : «Ô puissant, pourquoi ne nous enseignes-tu à lire ton livre. / Pourquoi ne passes-tu le long des signes ton doigt / pour nous apprendre à épeler et comprendre / comme des enfants.»), recueil intitulé Pays du soir (chez Arfuyen, livre à mon sens inutilement postfacé par Charles Juliet) pour publier dans la Zone un vieux texte consacré aux deux romans (il s’agirait plutôt de longues nouvelles) les plus connus de Lagerkvist, Le Bourreau et Le Nain.
«Il s’effrite comme un lépreux sur son trône et le vent sinistre de l’éternité répand sa poussière dans les déserts célestes».
Pär Lagerkvist, Le Bourreau.«Peut-être le Mal a-t-il une demeure éternelle,
Une aire lointaine, désolée, inaccessible
Où l’on aspire en vain à la rédemption,
Quelque chose d’impérissable comme la lumière même».
Pär Lagerkvist, Genius.
Nous allons tenter d’examiner ces deux étranges récits de Pär Lagerkvist sous le regard le plus déroutant, le seul, vital pour notre temps sans Dieu, regard qui du Christ fait un nain, dénué jusqu’au vertige de la plus petite parcelle de charité, regard qui du Christ fait un bourreau, cette fois digne de pitié. A dire vrai, il eût été plus juste d’inverser les termes de la provocante égalité – et de dire ainsi que Lagerkvist fait d’un nain ou d’un bourreau le Christ, moins même, une figure christique –, mais ce serait faire preuve d’une sotte prudence, et se condamner à sous-estimer la portée du renversement absolu, non seulement des valeurs, mais plus encore du sens de la verticalité, qui se joue dans ces deux œuvres – renversement de sens, inversion de polarité, que l’on trouve déjà dans Macbeth, pièce la plus noire de Shakespeare qui fait du héros éponyme un contre-Christ bien que, dans cette pièce, ce renversement ne soit pas aussi explicite et radical que chez Lagerkvist.
Le Nain (Dvärgen, 1944) donc, Piccolino, qui est l’auteur d’un récit à la première personne, monstrueux comploteur, difforme créature au service d’un prince d’une cour italienne de la Renaissance, qu’un critique et traducteur éminents, Régis Boyer, a tort de confondre avec Satan (dans son Introduction aux Âmes masquées, Flammarion, coll. G.F., 1986; certes, cette identification, le nain l’établit en personne : «Je me sentais comme Satan lui-même, entouré des esprits infernaux»; là pourtant n’est pas l’essentiel). Aussi méchant soit-il, notre nain n’est pas Satan : sa sensibilité délicate s’émeut de beaucoup de choses, de trop de choses, et certains tableaux violents lui donnent une franche nausée. Non, ce nain n’est pas Satan, mais plus : l’adversaire en personne de ce dernier, le Christ. Cette identification va infiniment plus loin que la précédente, puisqu’elle porte le soupçon du Mal au sein même de la divinité, au sein même du cœur du Fils de l’homme, et qu’elle n’érige plus seulement en figure trop évidente le diabolique. Le nain Piccolino est un Christ inverse, inversé, un contre-Christ, c’est-à-dire, un Antichrist, non pas le formidable émissaire du Diable, tout gorgé du sang des martyrs chrétiens que nous décrivent les textes anciens, mais un Antichrist veule, grotesque, méchant – non, intrinsèquement mauvais, Piccolino, comme on dit, a le Mal dans les veines –, un pitoyable solitaire dégoûté de tout et de tous, hormis, peut-être, de son maître, le Prince. Notre nain, c’est le Christ des Temps Modernes, le seul, ridicule et publicitaire, qui puisse convenir à nos temps troubles et oublieux de Dieu. Piccolino est un Christ de carnaval, ridicule mais conforme en tout point à son modèle. Simplement, le petit personnage ne s’est pas avisé qu’il regardait dans une glace son reflet contradictoire. C’est au cours d’une messe carnavalesque qu’il célèbre en personne, que notre nain va acquérir sa stature christique : «Je mange son corps, qui était difforme comme le vôtre», hurle-t-il à l’assemblée uniquement composée de nains, «Il est amer comme fiel, car il est plein de haine. Puissiez-vous en manger tous ! Je bois son sang, qui brûle comme un feu inextinguible. C’est comme si je buvais le mien.» L’opposition entre le nain et le Christ dès lors, de tracer une trame aisément repérable : l’Un est pure donation de Son corps aux hommes, l’autre pure réserve et égoïsme : «Mais je me hais aussi moi-même. Je dévore ma chair imbibée de fiel. Je bois mon sang empoisonné. Sombre évêque de mon peuple, j’accomplis chaque jour mon rite solitaire.» Le Christ vrai ne craint pas de dire qu’Un le surpasse, son Père; l’autre se veut sa propre origine, comme le Démon de saint Anselme de Cantorbéry : «Et je reconnais tout ce qui vient de moi, rien n’émerge des bas-fonds de mon être, car rien n’y est caché dans l’ombre. L’Un apporte la paix, l’autre la guerre farfelue et pitoyable du monstre, de la contrefaçon : «Sauveur des nains, puisse ton feu consumer le monde entier !», et la parodie se poursuit, dans ces quelques lignes par exemple, où Piccolino médite sur la personne du Christ, que Maître Bernardo (masque transparent de Maître Leonardo da Vinci) a représenté lors de la Cène : «La haine a été mon aliment depuis les premiers instants de ma vie, j’ai absorbé sa sève amère, le sein maternel sur lequel je reposais était plein de fiel, tandis que Jésus, lui, tétait la douce Madone, la plus tendre, la plus suave de toutes les femmes, et buvait le lait le plus délicieux qu’ait jamais goûté un être humain.» Remarquons alors que le nain infâme se représente sous les traits de Judas : «Je songeai avec joie que ce dernier allait bientôt être pris, que Judas, recroquevillé dans un coin, ne tarderait pas à le trahir. Il est encore aimé et honoré, pensai-je, il siège encore à sa table d’amour – tandis que je me tiens debout dans la honte !» [Piccolino pose en effet pour Maître Bernardo] «Mais son heure viendra ! Au lieux d’être assis avec les siens, il sera cloué sur la croix, trahi par eux. Et il y pendra nu, comme je le suis en ce moment, aussi honteusement avili ! Exposé aux regards de tous, raillé et injurié. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne subirait-il pas le même traitement que moi ?»
Le second récit, lui aussi bref – à peine plus d’une centaine de pages en édition de poche – pourrait être une sorte de geste du maudit, ici représenté par le personnage du bourreau, une amplification romanesque des quelques dizaines de lignes que le grand Joseph de Maistre consacre à l’exécuteur dans le Premier Entretien de ses Soirées de Saint-Pétersbourg. Ce court texte date de 1933 et a été adapté au théâtre avec Gösta Ekman. Le Bourreau est ce personnage, honni de tous, qui symbolise le Mal absolu. Mais le bourreau qui est le serviteur du Mal, le compagnon préféré de Satan, est le Christ aussi, est le Christ pourtant, est le Christ plus que le Christ. Le Fils de l’homme, qui obsède Lagerkvist dans ses derniers récits, Lagerkvist qui est aux prises avec Lui et qui, comme Jacob avec l’ange, ferraille dur, le Christ que l’on retrouve, mais inversé, dans le très cruel récit Le Nain, comme une contre-épreuve, un petit Christ minable et joyeux de l’être, même pas Satan, rien qu’une caricature grotesque, un parasite informe et atone, content d’être là et de faire le Mal à sa toute petite et puérile échelle, sans aucune ascension de Golgotha, sans désespoir, sans peur de la mort et sans l’angoisse d’être abandonné au dernier moment (car Piccolino n’a pas peur; emprisonné, torturé, il est absolument incapable d’éprouver la peur du Christ face à son agonie. Le nain n’a pas peur, car, dit-il, il ne s’ignore pas : «Et je reconnais tout ce qui vient de moi […]. Aussi n’ai-je point peur de ce qui effraie les autres, de cet hôte bizarre et mystérieux»). A moins que le nain ne soit assimilable au Dieu mort. Il faut ainsi remarquer la similarité de deux scènes, évoquant l’une et l’autre la solitude stupide de ce qui n’a plus aucune raison d’être : la première décrit la vision du Dieu mort dans notre nouvelle, la seconde, celle du nain emprisonné : «Je suis là dans mes fers et les jours passent et il n’arrive jamais rien. C’est une existence vide et sans joie, mais je m’y trouve bien. J’attends d’autres temps qui viendront sans doute. Il n’a sûrement jamais été question que je reste ici pour toujours. Je trouverai bien l’occasion de poursuivre ma chronique au grand jour, comme avant, et l’on trouvera bien, de nouveau, à m’employer. Si je connais bien mon maître, il ne pourra pas se passer de son nain, à la longue.»
Suivons pas à pas la narration de notre deuxième nouvelle – et comprenons que la critique, bien souvent, devrait se contenter de ce seul rôle fort modeste. Et d’abord, ce bourreau, personnage tutélaire et thuriféraire du Mal, ne parle pas, ne vit pas, n’est pas mis en scène autrement que par une présence qui est absence. La nouvelle commence dans une taverne mal famée : «Attablé dans la pénombre de la taverne, le bourreau buvait». C’est tout ce qu’on nous dit ou presque. Immédiatement alors surgit la conversation entre les différents arsouilles qui peuplent le lieu interlope : tous parlent du bourreau, car «Oui, c’est effrayant de ce que les gens sont avides de tout ce qui se rapporte à lui», cet être nocturne, présenté comme l’allié, l’émissaire du Diable : le bourreau est celui «qui se tient si près du Malin». C’est le premier chapitre, qui se termine sur la prise de parole d’un des ivrognes, qui durant tout le deuxième chapitre va raconter l’expérience qu’il vécut jadis, enfant, à laquelle le bourreau fut intimement mêlé : «Il n’est pas facile de connaître à fond le Malin, et lorsqu’on y arrive, on peut avoir des surprises. Ce n’est pas que j’y comprenne grand-chose moi-même, mais un jour le Malin m’a pour ainsi dire tenu entre ses mains et m’a laissé voir son visage. Enfant, ce narrateur momentané a joué avec les deux enfants d’un bourreau, vivant à l’écart du reste des habitations. Ayant pénétré dans sa demeure et s’étant approché d’une épée accrochée au mur, celle-ci a gémi. Aucun doute pour la compagne du bourreau, qui interprète le signe maléfique : c’est par l’épée du bourreau qu’un jour l’enfant devenu adulte périra. La conjuration funeste est défaite, le jour où le bourreau, par trois fois, fait boire dans sa main à l’enfant l’eau d’un puits auquel puise la famille proscrite. «Que Dieu vous bénisse», s’exclame la mère du petit au bourreau. Mais, pour toute réponse, nous dit le narrateur, le bourreau «se détourna». «Le Malin est bizarre, qui peut le nier ?», est la première des constatations à faire, suivie par cette autre, surprenante, «On dirait qu’il y a quelque chose de bon en lui». Il faut faire donc le constat de la force mystérieuse qui gît dans le Mal, capable de sauver une vie que la fatalité enchaînait pourtant à son pouvoir de mort.
C’est là le premier renversement qu’opère le texte : le Mal est bénéfique dans certaines conditions, point ne sert de se le cacher. Jusqu’à présent, le bourreau n’a pas ouvert la bouche, peut-être même n’écoute-t-il pas les histoires que se racontent les hommes. Un deuxième narrateur prend alors le relais du premier. C’est une histoire d’amour qu’il va nous raconter, entre un bourreau et la femme qu’il devait exécuter. Au moment de trancher la tête adorable, il avoue ne pas pouvoir le faire : tout le monde le sait, c’est un motif suffisant – le seul, à vrai dire – pour que la condamnée soit graciée (certes, comme il faut encore préserver la «part du gibet», la femme sera marquée au fer rouge). Hélas, lorsqu’un enfant naîtra au couple singulier, son front sera marqué d’une tache en forme de potence. Horrifiée, l’ancienne condamnée tue son enfant, et pour ce crime elle est enterrée vivante par son propre époux. Après cette deuxième histoire – et le bourreau attablé dans la taverne n’a toujours pas prononcé un seul mot –, un intermède grotesque a lieu, qui fait s’ouvrir la gueule de l’Enfer : le Mal s’y déchaîne, servi par le hideux Lasse, voleur de grand chemin sans main, qui déclare posséder un trésor démoniaque dans l’objet singulier dont il est devenu le possesseur, une mandragore. Lorsqu’il a arraché celle-ci, au pied même de la potence, à l’endroit où l’on enterre les pendus lorsque le vent les a fait tomber, voici ce qu’il a entendu : «Et quand je l’arrachai de terre, il y eut un fracas épouvantable autour de moi, ça grondait et tremblait ! – l’abîme s’ouvrit, du sang et des cadavres en jaillirent ! – l’obscurité se fendit et du feu coula sur le monde ! quelle horreur et quels cris ! – et tout brûlait ! – on aurait dit que l’enfer avait été lâché sur la terre ! – «Voilà que je la tiens ! je la tiens !» ai-je crié !» Mais alors qu’éclatent dans la gargote ces paroles hallucinées, le bourreau, «toujours immobile et comme hors du temps, fixait gravement l’obscurité devant lui». Comme s’il savait depuis longtemps que sa présence néfaste jamais n’allait se démentir tout au long du gouffre des âges futurs, comme s’il voyait déjà la hideuse prolifération du Mal dont il est le serviteur.
Il a raison. Les années ont passé, creusant un peu plus profond le gouffre du Mal. Le quatrième chapitre débute, de nouveau, sur l’intérieur bruyant d’une taverne, quelques siècles après le cadre d’ouverture de la nouvelle, ou quelques heures, peu importe. Le bourreau, une fois de plus, est muet : le Mal en personne se tait, peut-être regarde-t-il – mais rien n’est moins sûr – les hommes – des soldats nazis, nouvelle incarnation temporelle et temporaire du Mal – en train de s’amuser au son d’un orchestre noir. Un dilemme de pensée totalitaire, un meurtre qui le solde rapidement, et puis la bagarre éclate entre l’orchestre et les Allemands. Enfin, après celle-ci, qui se conclut par quelques morts, un soldat interpelle le bourreau, dans un panégyrique qui mêle au salut des nouveaux dieux de la horde, l’exaltation de la sainte violence et la certitude réjouissante que la silhouette puissante du bourreau remplira les guerriers de confiance et de courage. «Heil ! Heil !», crie le soldat au bourreau; mais ce dernier garde le silence, continue à «les regarder sans souffler mot». Puis il prend la parole, pour ne plus la laisser jusqu’à la fin. Oui, à ceux qui en doutaient, il crie qu’il est bien le bourreau. C’est lui qui, depuis les premier âges du monde, vagissants encore depuis qu’ils ont quitté leur berceau d’infamie, c’est lui qui suit pas à pas la carrière frénétique et grotesque des Hommes : «On m’appelle encore et j’arrive, car c’est pour le mal l’époque du rut ! C’est l’heure du bourreau !» Comme Caïn dont il est le frère infortuné, le bourreau, parce qu’il porte sur le front la marque du crime, est condamné à n’être qu’un tueur, pour l’éternité. Selon la logique propre au sacré – sacer : toujours l’étymologie est révélatrice – dont il est la figure mystérieuse et symbolique, le bourreau est le Mal et le Bien, l’exécuteur et sa victime : le bourreau est condamné à servir les hommes, il est aveuglé par leur sang, qu’il répand en larges torrents – condamnations, guerres, sacrifices religieux, etc. –, qui pourtant est le sien, selon cette étonnante préfiguration de la parenté christique : le sang des hommes est celui du bourreau et le sang du bourreau, comme le sang vivificateur du Fils de l’homme, circule en l’humanité. Il porte, pas moins que l’absurde Sisyphe, un fardeau: il est, selon ses paroles, le seul à le faire : «Je dois porter vos fardeaux, suivre vos chemins sans me lasser, tandis que dans vos tombeaux vous reposez depuis longtemps. Qui creusera une tombe assez profonde pour me cacher ? Pour me donner la paix ? Qui soulèvera de mes épaules le fardeau de la malédiction et me procurera le repos de la mort ? Personne !», s’exclame le bourreau, car «personne ne serait capable de porter ce que je porte.» Personne ? Ne reste-t-il pas, même pour le pire des criminels, même pour le Gilles de Rais le plus délectablement pervers, le recours d’adresser ses prières à Dieu ? Non, répond le bourreau, car Dieu, cela est sûr depuis belle lurette, est mort et bien mort. À dire vrai, le bourreau a certes éprouvé le désir de parler au créateur, mais à une époque reculée, à «l’époque où il y avait encore un Dieu», afin, nous dit-il, de «plaider [sa] cause devant lui». Plus précisément encore, la veille de la grande exécution accomplie par le bourreau, celle d’un homme qui se prétend le sauveur des hommes, qui s’appelle le Messie, qui a prêché la paix sur la terre. Incompréhension du bourreau qui s’entretient quelque instant avec le pauvre diable: pourquoi la paix nécessite-t-elle que meurt celui qui la désire et aspire à elle de ses vœux, de toutes ses forces de Dieu ? C’est, répond étrangement l’homme qui se prétend le fils de Dieu, une «convention mystique» entre lui et son père. Pourtant, au moment de l’agonie, et juste avant celle-ci, lorsqu’il s’agit d’aider le condamné à porter la croix sur laquelle il va être cloué par le bourreau, nul autre que ce dernier ne se trouvera pour l’aider. Lui seul est venu à son secours et nul autre, car, bien entendu, «son fardeau pesait moins que ce [que le bourreau] porte d’habitude pour les hommes». Le bourreau est donc devenu Simon de Cyrène, – pas encore le Christ –, comme, auparavant (dans la narration, non dans la logique temporelle, mais qu’importe ?), il avait aidé le jeune enfant, ou encore sauvé celle qu’il allait épouser. Au moment de le mettre en croix, le Christ murmure «Je te pardonne, frère» au bourreau, dont un témoin prétend qu’alors la marque inscrite sur son front disparut. Parce que le Christ a appelé frère le bourreau, celui-ci a l’impression de crucifier son propre frère : désormais, cette certitude sera inébranlable dans l’esprit du tortionnaire. Après la mort du Christ et la profération de son cri formidable – «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’avez-vous abandonné ?» –, le bourreau, assis près du lieu du supplice, a l’idée d’aller parler à Dieu. «Je quittai la terre et m’élevai dans les cieux», nous dit le personnage, comme dans les vieilles apocalypses juives, «où du moins l’air n’est pas étouffant et fade. J’ai marché, marché, je ne sais combien de temps. Il habitait terriblement loin, Dieu. Enfin, je le découvris trônant devant moi, grand et puissant, dans l’immensité céleste.» Alors le bourreau parle, comme il ne l’a jamais fait ni ne le fera plus jamais. Comme on dit, il se déverse, car comment ne pas conter sa misère au Dieu de tous les âges ? Cela est inutile, car nous assistons à la vision du Dieu mort qui «s’effrite comme un lépreux sur son trône. Mais il ne me voyait pas. Ses yeux bombés, au regard vide comme le désert, fixaient toujours l’espace. Je fus pris de crainte et d’un désespoir au-dessus de mes forces. «Aujourd’hui j’ai crucifié ton propre fils !» lui criai-je, fou de rage. Mais aucun trait de son visage dur et impassible ne bougea. Il semblait taillé dans la pierre. Seul dans le silence et le froid, je sentais le vent de l’éternité me glacer. Il n’y avait rien à faire. Personne à qui parler. Rien. Je dus reprendre ma hache et rebrousser chemin. Je compris que le crucifié n’était pas son fils. Il faisait partie des hommes et ce n’était pas étonnant qu’on l’eût traité comme ils ont l’habitude de traiter les leurs.»
Le texte, bien sûr, est superbe : il nous fait penser à telle page de Dostoïevski – la légende du Grand Inquisiteur ? – et nous permet de saisir le retournement par lequel désormais le bourreau va pouvoir se prétendre Christ. Comment L’autre pouvait-il se dire Sauveur, alors qu’Il n’est pas même capable de venir en aide au bourreau, celui-là même qui en a le plus pressant besoin ? Non, le Christ véritable, le seul que méritent les hommes inhumains, c’est lui, le Mal incarné, le bourreau, abandonné de tous, mais présent fantastiquement, alors que l’autre, le frère supplicié, est parti et qu’il n’était pas, d’ailleurs, le fils de Dieu. «Mais moi, je suis le Christ, je vis !», crie le bourreau, qui alors n’aspire, comme son frère abandonné, qu’à se faire crucifier, bien qu’il sache que jamais sa croix ne sera dressée, car le Mal sans aucun doute n’aura pas de fin et, s’il en avait une par hasard, qu’en ferait-il, lui ? Est-ce que pour autant cela amoindrirait son indicible souffrance ? Est-ce que pour autant ses crimes lui seraient pardonnés ? «Et néanmoins j’aspire à cela. A ce que ce soit fini, à ce que ma culpabilité cesse d’augmenter. J’aspire au moment où vous [vous, les hommes] serez effacés de la terre et où mon bras pourra enfin retomber. Aucune voix rauque ne se lèvera plus vers moi, je serai seul et en regardant autour de moi je comprendrai que tout est accompli. Et je m’en irai dans la nuit éternelle», conclut-il, désespérément. Désespérément ? Certes, la profondeur de l’angoisse atteinte dans ce court récit, l’irréparable doute porté sur la divinité du Christ, la certitude définitive de la mort de Dieu, enfin la pérennité de la mission du bourreau et de la présence du Mal, enté au plus intime des flancs de l’humanité, tout cela plaide pour une noirceur irréfragable. Mais il reste, encore une fois comme dans l’œuvre du grand Russe, le secours de la femme, de l’amour que celle-ci porte à son compagnon de misère. Qui est-elle ? Nul ne le sait, pas même le bourreau : «Je ne sais pas qui elle est, mais elle est bonne pour moi. Quand la nuit est tombée, elle passe sa main sur mon front et me dit que la marque au fer rouge a disparu. Elle ne ressemble à personne, elle peut m’aimer. J’ai demandé aux hommes qui elle est, mais nul ne la connaît.» Dans un univers renversé, inversé, mis sens dessus dessous depuis que Dieu est mort, au point que le bourreau est le seul à pouvoir prétendre remplacer un Christ misérable et abandonné, sans que cela ne puisse même pas – plus ? – nous choquer, il ne reste plus rien qu’une morne route qui se fraie son passage au creux d’une Mer Rouge de gibets, de cadavres et d’abominations: mais au loin, c’est peut-être bien le soleil rescapé de l’amour qui luit encore.
Juan Asensio (voir l’article sur Stalker)
Le Bourreau et Le Nain, ainsi que les titres majeurs de Lagerkvist sont publiés par les éditions Stock, dans la collection de poche Bibliothèque Cosmopolite.