Partagez, c'est revevoir (notre lettre d'info) :
L'agenda des sorties dans votre ville et département est ici :
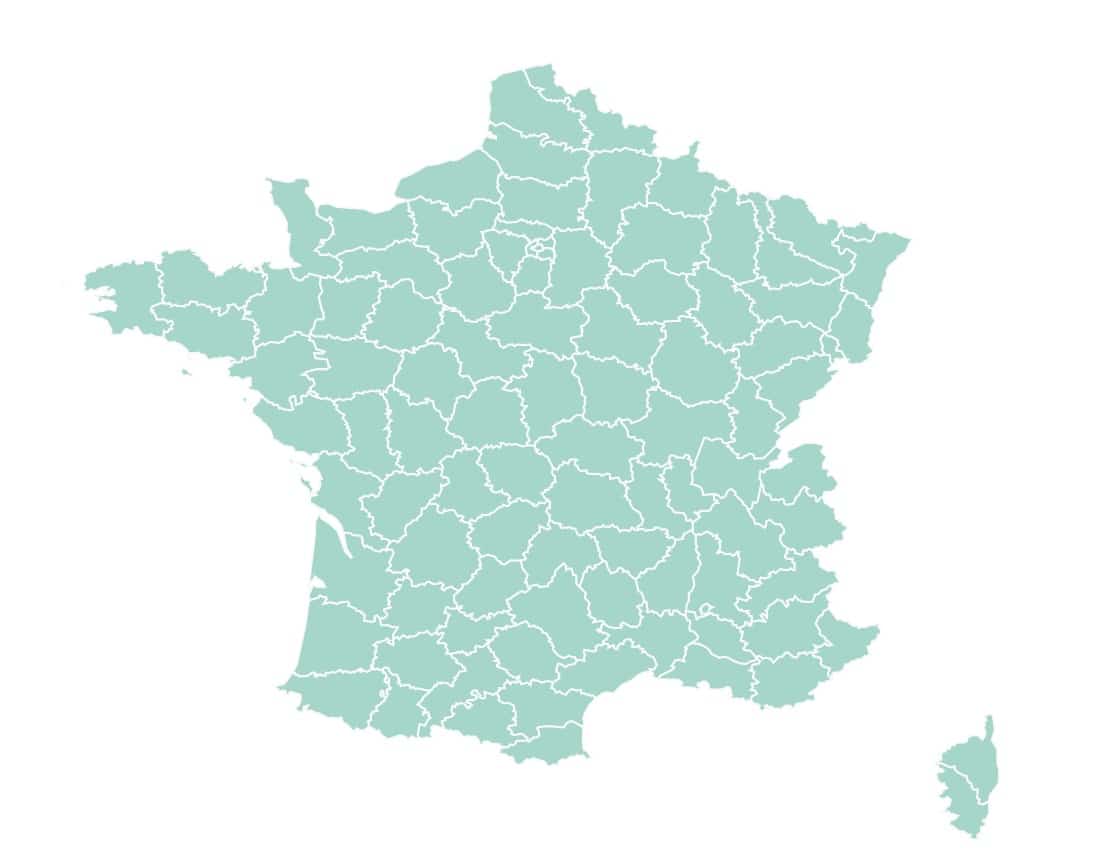
Pour ajouter gratuitement un événement en quelques secondes cliquez ici…
Recevez notre lettre d'info hebdomadaire :

Partagez, c'est revevoir (notre lettre d'info) :
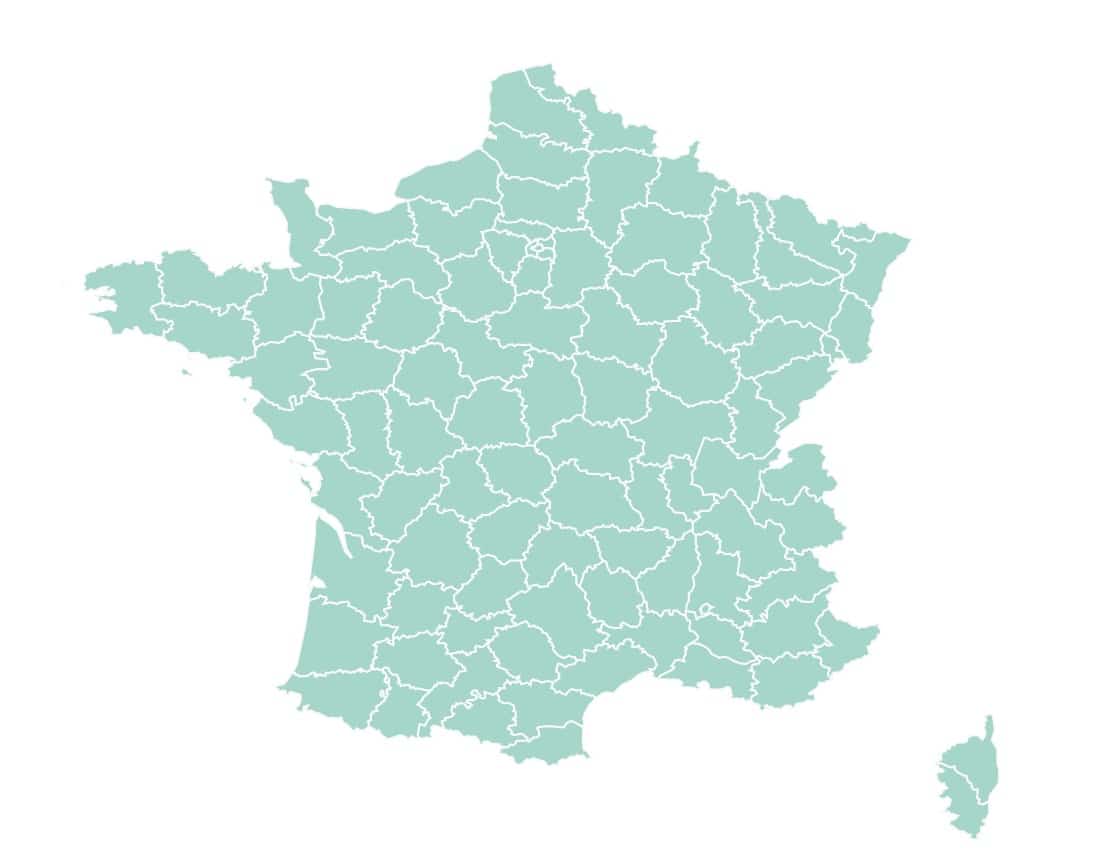
Pour ajouter gratuitement un événement en quelques secondes cliquez ici…
Recevez notre lettre d'info hebdomadaire :
