Avec ce nouveau « roman » publié par les éditions Actes Sud, l’écrivain Javier Cercas revisite, à travers l’imposture d’Enric Marco, l’histoire espagnole du XXe siècle.
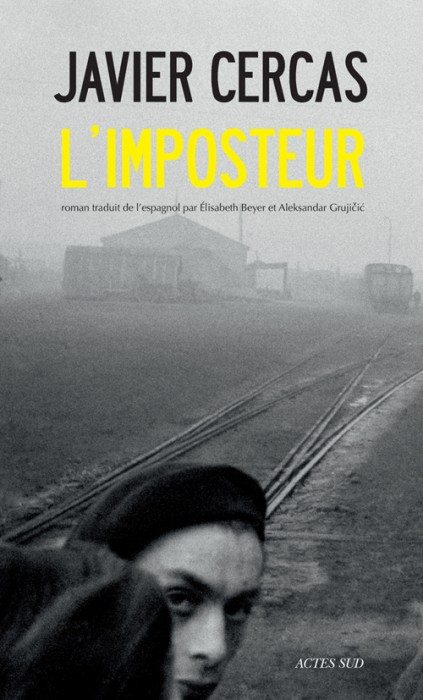 « Telle est l’infamie stricte, celle qui, n’étant mélangée ni de scandale ambigu ni d’une sourde admiration, ne compose avec aucune sorte de gloire », écrit Michel Foucault dans La Vie des hommes infâmes, en 1977. Voilà peut-être la phrase par laquelle nous pourrions contredire Javier Cercas si lui-même ne dramatisait pas, dans L’imposteur, le danger d’écrire sur Enric Marco. Avec Primo Levi, puis Tzvetan Todorov, Cercas se demande si « comprendre, c’est justifier ». L’infamie, entendue comme ce qui n’est pas dit, ce qui n’est pas reconnu ou renommé, devrait-elle être le sort de cet imposteur ? En 2005, un historien du nom de Benito Bermejo dévoile le scandale : Enric Marco, ancien syndicaliste, président de l’Amicale de Mauthausen, témoin charismatique et émouvant des survivants espagnols de l’Holocauste – en tant qu’ancien prisonnier au camp de Flossenbürg, en Bavière – connu pour avoir ému jusqu’aux larmes plusieurs enfants ou petits-enfants de déportés, avait en vérité menti sur son destin victimaire. Enric Marco s’est effectivement rendu en Allemagne durant le IIIe Reich mais uniquement dans le cadre d’un accord passé entre Hitler et Franco sur la venue de travailleurs volontaires espagnols au sein du territoire allemand. Cette révélation, qui a ébranlé l’Espagne et mobilisé de nombreux témoignages d’intellectuels, dont Magris, Vargas Llosa et Cercas lui-même, méritait-elle d’être racontée ? Est-ce un devoir de la dire ? Un devoir de la taire ? Pour mettre ces questions en perspective, Cercas élabore une structure romanesque et une entité narrative complexe, lesquelles s’attachent, paradoxalement, à produire « un roman sans fiction » ou encore « un récit rigoureusement réel ». Cercas, comme dans certains de ses romans antérieurs, à la manière de Carrère également, se met lui-même en scène. Le début du roman commence par sa fin, pour ainsi dire, s’amorce sur l’idée de ne pas se montrer, de se terminer tout de suite.
« Telle est l’infamie stricte, celle qui, n’étant mélangée ni de scandale ambigu ni d’une sourde admiration, ne compose avec aucune sorte de gloire », écrit Michel Foucault dans La Vie des hommes infâmes, en 1977. Voilà peut-être la phrase par laquelle nous pourrions contredire Javier Cercas si lui-même ne dramatisait pas, dans L’imposteur, le danger d’écrire sur Enric Marco. Avec Primo Levi, puis Tzvetan Todorov, Cercas se demande si « comprendre, c’est justifier ». L’infamie, entendue comme ce qui n’est pas dit, ce qui n’est pas reconnu ou renommé, devrait-elle être le sort de cet imposteur ? En 2005, un historien du nom de Benito Bermejo dévoile le scandale : Enric Marco, ancien syndicaliste, président de l’Amicale de Mauthausen, témoin charismatique et émouvant des survivants espagnols de l’Holocauste – en tant qu’ancien prisonnier au camp de Flossenbürg, en Bavière – connu pour avoir ému jusqu’aux larmes plusieurs enfants ou petits-enfants de déportés, avait en vérité menti sur son destin victimaire. Enric Marco s’est effectivement rendu en Allemagne durant le IIIe Reich mais uniquement dans le cadre d’un accord passé entre Hitler et Franco sur la venue de travailleurs volontaires espagnols au sein du territoire allemand. Cette révélation, qui a ébranlé l’Espagne et mobilisé de nombreux témoignages d’intellectuels, dont Magris, Vargas Llosa et Cercas lui-même, méritait-elle d’être racontée ? Est-ce un devoir de la dire ? Un devoir de la taire ? Pour mettre ces questions en perspective, Cercas élabore une structure romanesque et une entité narrative complexe, lesquelles s’attachent, paradoxalement, à produire « un roman sans fiction » ou encore « un récit rigoureusement réel ». Cercas, comme dans certains de ses romans antérieurs, à la manière de Carrère également, se met lui-même en scène. Le début du roman commence par sa fin, pour ainsi dire, s’amorce sur l’idée de ne pas se montrer, de se terminer tout de suite.
Je ne voulais pas écrire ce livre. Je ne savais pas exactement pourquoi je ne voulais pas l’écrire ou bien si, je le savais, mais je ne voulais pas le reconnaître ou je ne l’osais pas ; ou pas complètement. Le fait est que, pendant plus de sept ans, je me suis refusé à écrire ce livre. Entre-temps, j’en ai écrit deux autres, sans cesser de penser à celui-ci ; loin de là : à ma manière, tandis que j’écrivais ces deux livres, j’écrivais aussi celui-ci. Ou peut-être était-ce ce livre-ci qui, à sa manière, m’écrivait moi.
Les premiers paragraphes d’un livre sont toujours les derniers que j’écris. Ce livre est terminé. Ce paragraphe est le dernier que j’écris. Et, comme c’est le dernier, je sais à présent pourquoi je ne voulais pas écrire ce livre. Je ne voulais pas l’écrire parce que j’avais peur. Je le savais depuis le début mais je ne voulais pas le reconnaître ou je ne l’osais pas ; ou pas complètement. Ce n’est que maintenant que je sais que ma peur était justifiée . (p. 13)
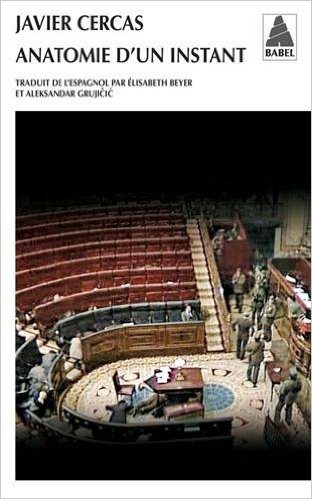 De là, L’Imposteur se présente comme le roman d’un roman plus vaste, d’un roman à venir. Déceptif dans son principe central, le texte se pose en prétexte – prétexte à réfléchir la question, finalement déontologique, pour ne pas dire éthique, de savoir comment raconter la vie et l’imposture de Marco. Le Javier Cercas dépeint dans le roman ne veut plus écrire de « récit réel » – comme L’Anatomie d’un instant – parce que « la fiction sauve » et « la réalité tue ». Paradoxalement, non seulement toute fiction à propos d’Enric Marco semble impossible – parce qu’il est en lui-même sa propre fiction, « le romancier de soi-même » – mais, de fait, pourrait s’avérer immoral. La première stratégie de Cercas visait à mettre en scène – en fait, en abyme – la gestation et l’hésitation du projet lui-même, présenté comme un livre non abouti. La deuxième réside dans un flottement – lequel constitue le motif central de son œuvre – non seulement entre la réalité et la fiction, mais surtout dans leur intrication, leur perméabilité. La recherche de la vérité en dépend. Si parfois la fiction, dans la littérature lazaréenne aussi, vient combler la béance du réel, comme chez Georges Perec, par exemple, dans le cas de Marco, c’est précisément la fiction, pourrait-on dire, la débauche fictionnelle, qui l’en empêche. Comment peut-on écrire le roman d’une histoire vraie, en substance plus fictionnelle qu’un roman pourrait l’être ? Si la réalité, parfois, dépasse la fiction, comment l’écrire ? Sur ce point, le récit de Cercas est doublement efficace ; d’une part, parce qu’il se construit sur ses propres limites, sur son propre échec, brasse, dans un mouvement métatextuel et réflexif, ses propres contradictions et s’écrit en marge de la fiction d’Enric Marco ; d’autre part, en parvenant selon une structure complexe à raconter l’histoire de cette polémique, parce que ce récit propose en amont, outre une historiographie en creux de l’histoire espagnole, une méditation sur l’imposture en nous.
De là, L’Imposteur se présente comme le roman d’un roman plus vaste, d’un roman à venir. Déceptif dans son principe central, le texte se pose en prétexte – prétexte à réfléchir la question, finalement déontologique, pour ne pas dire éthique, de savoir comment raconter la vie et l’imposture de Marco. Le Javier Cercas dépeint dans le roman ne veut plus écrire de « récit réel » – comme L’Anatomie d’un instant – parce que « la fiction sauve » et « la réalité tue ». Paradoxalement, non seulement toute fiction à propos d’Enric Marco semble impossible – parce qu’il est en lui-même sa propre fiction, « le romancier de soi-même » – mais, de fait, pourrait s’avérer immoral. La première stratégie de Cercas visait à mettre en scène – en fait, en abyme – la gestation et l’hésitation du projet lui-même, présenté comme un livre non abouti. La deuxième réside dans un flottement – lequel constitue le motif central de son œuvre – non seulement entre la réalité et la fiction, mais surtout dans leur intrication, leur perméabilité. La recherche de la vérité en dépend. Si parfois la fiction, dans la littérature lazaréenne aussi, vient combler la béance du réel, comme chez Georges Perec, par exemple, dans le cas de Marco, c’est précisément la fiction, pourrait-on dire, la débauche fictionnelle, qui l’en empêche. Comment peut-on écrire le roman d’une histoire vraie, en substance plus fictionnelle qu’un roman pourrait l’être ? Si la réalité, parfois, dépasse la fiction, comment l’écrire ? Sur ce point, le récit de Cercas est doublement efficace ; d’une part, parce qu’il se construit sur ses propres limites, sur son propre échec, brasse, dans un mouvement métatextuel et réflexif, ses propres contradictions et s’écrit en marge de la fiction d’Enric Marco ; d’autre part, en parvenant selon une structure complexe à raconter l’histoire de cette polémique, parce que ce récit propose en amont, outre une historiographie en creux de l’histoire espagnole, une méditation sur l’imposture en nous.
Ce qui est sûr, c’est que la fiction sauve Narcisse et que, si Marco est à sa manière narcissique, ses mensonges l’ont peut-être sauvé : Marco a été un orphelin arraché de force à sa mère, une femme pauvre, folle et maltraitée par son mari, il a été un enfant nomade et privé de l’affection des autres, un adolescent enflammé par une révolution fugace, vaincu par une guerre épouvantable, un perdant-né qui, à un moment donné de sa vie pour conquérir l’admiration et l’amour qu’il n’avait jamais reçus, a décidé d’inventer son passé, de se réinventer, de construire avec sa vie une fiction glorieuse dans le dessein de cacher la réalité médiocre et honteuse, de raconter qu’il n’est pas celui qu’il est et qu’il n’a pas été celui qu’il a été – un homme absolument normal, un membre de l’immensité majorité silencieuse, lâche, grisâtre et déprimante qui dit toujours Oui – mais un individu exceptionnel, un de ces individus singuliers qui disent toujours Non, ou qui disent Non quand tout le monde dit Oui ou simplement quand il est plus important de dire Non, au début de la guerre d’Espagne un combattant exalté, presque encore un enfant, opposé au fascisme, exposé au risque et à la fatigue extrêmes, pendant la guerre, un guerrier anarchiste intrépide opérant derrière les lignes ennemies, après la guerre, le premier ou l’un des premiers résistants téméraires contre le franquisme victorieux et un exilé politique, une victime et un combattant contre le nazisme, un héros de la liberté. Voilà les mensonges de Marco. Voilà la fiction qui l’a peut-être sauvé puisque, comme dans le cas de Narcisse, elle l’a empêché pendant de nombreuses années de se connaître ou de se reconnaître tel qu’il était. Bien sûr, si ces mensonges ont sauvé Marco, la vérité que je raconte dans ce livre le tuera. Parce que la fiction sauve, mais la réalité tue. (p. 148)
 Cercas, à plusieurs reprises, se demande s’il n’est pas, en tant que personne mais surtout comme romancier, une sorte d’imposteur. Entendons peut-être ce terme comme ce qui n’a pas ou ce qui est privé de posture, de position, de situation. Cercas confronte les multiples récits de Marco et ses propres investigations. L’écart qui se creuse entre les versions n’est pas toujours celui d’un mensonge à proprement parler : disons avec Cercas que « les mensonges se construisent sur de petites vérités ». Un exemple parmi d’autres : lorsque la guerre civile se termine en 1939, et que Marco décide de demeurer, malgré son passé anarchiste, à Barcelone, il se présente a posteriori comme un clandestin, capable ici de mener une résistance passive, symbolique, en refusant, dans les salles de cinéma, de faire le salut phalangiste, suffisamment courageux, ailleurs, pour devenir le cerveau de l’UJA – Union des Jeunes Antifascistes. Ce que nous apprend la recherche de Cercas sur ce point – laquelle est moins, finalement, une construction esthétique qu’une enquête historique – c’est que la fiction que Marco donne de lui-même procède d’une gestation narcissique par laquelle il se sauve du déshonneur, de la frustration d’avoir, comme tous ou presque à cette époque, été contraint de saluer la Phalange ou se taire. La fiction sauve, mais n’est pas pour autant salutaire d’un point de vue éthique. La fiction que Marco s’est façonnée se construit avant tout sur l’échec. Si Cercas met en scène la peur qui l’empêche d’écrire cette histoire, c’est qu’il sait pertinemment qu’elle excède en un sens le seul mensonge d’Enric Marco, lequel a trouvé, depuis les années 80 jusqu’à 2005, un terrain propice à la victimisation excessive et la culpabilité d’une nation entière confrontée à son silence et sa passivité. Quand il cite Faulkner, pour qui le passé « n’est même pas passé », Cercas ravive non seulement les stigmates de près d’un demi-siècle de franquisme, mais plus globalement les traces de la barbarie, et ce jusqu’à la dérive de la mémoire historique dès lors qu’elle est détériorée. Celan écrit que nul ne témoigne pour le témoin ; Cercas s’attache à résoudre une problématique autrement plus complexe, s’entend : qui témoigne pour le témoin désavoué, le témoin fallacieux ? Et surtout, comment ? Le texte, émargement surinvesti d’un mensonge réitéré sur plusieurs décennies, multiplie les variations pour rechercher quelque chose comme une vérité. Si la langue de Cercas est simple, la virtuosité de la composition recoupe sans cesse des problématiques capitales ; ainsi, par exemple, de ce passage où, du discours d’Enric Marco, rapporté par le narrateur au style direct, le texte finit par s’approprier ses paroles, au risque – mais Cercas, avec lucidité, nous présente ce risque – de suggérer une connivence entre le personnage et l’auteur. De même, Cercas invite à l’appréciation d’un paradoxe : à partir du témoignage, même tronqué, d’Enric Marco, le texte exhume l’existence de cette Union des Jeunes Antifascistes, résistance partiellement isolée, et selon l’auteur, peu reconnue. Cercas, sur ce point, se permet un hommage et inventorie les noms de ces 21 résistants peu ou prou oubliés par l’histoire.
Cercas, à plusieurs reprises, se demande s’il n’est pas, en tant que personne mais surtout comme romancier, une sorte d’imposteur. Entendons peut-être ce terme comme ce qui n’a pas ou ce qui est privé de posture, de position, de situation. Cercas confronte les multiples récits de Marco et ses propres investigations. L’écart qui se creuse entre les versions n’est pas toujours celui d’un mensonge à proprement parler : disons avec Cercas que « les mensonges se construisent sur de petites vérités ». Un exemple parmi d’autres : lorsque la guerre civile se termine en 1939, et que Marco décide de demeurer, malgré son passé anarchiste, à Barcelone, il se présente a posteriori comme un clandestin, capable ici de mener une résistance passive, symbolique, en refusant, dans les salles de cinéma, de faire le salut phalangiste, suffisamment courageux, ailleurs, pour devenir le cerveau de l’UJA – Union des Jeunes Antifascistes. Ce que nous apprend la recherche de Cercas sur ce point – laquelle est moins, finalement, une construction esthétique qu’une enquête historique – c’est que la fiction que Marco donne de lui-même procède d’une gestation narcissique par laquelle il se sauve du déshonneur, de la frustration d’avoir, comme tous ou presque à cette époque, été contraint de saluer la Phalange ou se taire. La fiction sauve, mais n’est pas pour autant salutaire d’un point de vue éthique. La fiction que Marco s’est façonnée se construit avant tout sur l’échec. Si Cercas met en scène la peur qui l’empêche d’écrire cette histoire, c’est qu’il sait pertinemment qu’elle excède en un sens le seul mensonge d’Enric Marco, lequel a trouvé, depuis les années 80 jusqu’à 2005, un terrain propice à la victimisation excessive et la culpabilité d’une nation entière confrontée à son silence et sa passivité. Quand il cite Faulkner, pour qui le passé « n’est même pas passé », Cercas ravive non seulement les stigmates de près d’un demi-siècle de franquisme, mais plus globalement les traces de la barbarie, et ce jusqu’à la dérive de la mémoire historique dès lors qu’elle est détériorée. Celan écrit que nul ne témoigne pour le témoin ; Cercas s’attache à résoudre une problématique autrement plus complexe, s’entend : qui témoigne pour le témoin désavoué, le témoin fallacieux ? Et surtout, comment ? Le texte, émargement surinvesti d’un mensonge réitéré sur plusieurs décennies, multiplie les variations pour rechercher quelque chose comme une vérité. Si la langue de Cercas est simple, la virtuosité de la composition recoupe sans cesse des problématiques capitales ; ainsi, par exemple, de ce passage où, du discours d’Enric Marco, rapporté par le narrateur au style direct, le texte finit par s’approprier ses paroles, au risque – mais Cercas, avec lucidité, nous présente ce risque – de suggérer une connivence entre le personnage et l’auteur. De même, Cercas invite à l’appréciation d’un paradoxe : à partir du témoignage, même tronqué, d’Enric Marco, le texte exhume l’existence de cette Union des Jeunes Antifascistes, résistance partiellement isolée, et selon l’auteur, peu reconnue. Cercas, sur ce point, se permet un hommage et inventorie les noms de ces 21 résistants peu ou prou oubliés par l’histoire.  La question générale de l’imposture prend, quoiqu’avec distanciation, voire avec ironie, une portée tragique ; en convoquant la figure de Narcisse, mais aussi celle de Don Quichotte, Cercas regarde son protagoniste, parfois, avec une compassion paradoxale, envisageant dans ce destin subsumé soudain dans le geste d’un mensonge tout ce qui peut sembler désespérant dans ces vies qui ne se réalisent pas, qui, selon la formule consacrée, passent à côté d’elles-mêmes. L’imposture en nous – dont Cercas se rend ouvertement coupable – celle-là même qui peut-être distingue le héros des autres, qui en tout cas falsifie la vérité au profit d’une justification mensongère, trouve dans ce livre un écho universel. Javier Cercas l’imposteur ? Le rapprochement, sur la couverture, du titre du livre et son auteur pourrait le suggérer. Mais s’il est une réflexion que sous-tend ce roman, ce serait peut-être, non la porosité qui agite la fiction et la réalité, mais bien la fiction et le mensonge. Si Enric Marco est un menteur, Javier Cercas est un auteur de fiction. Cercas, qui pousse loin la réflexion sur l’éthique de l’auteur, prend conscience que, si la fiction sauve et la réalité tue, alors ce qu’il entreprend court le risque de tuer celui dont il relate le mensonge, et avec lui peut-être une partie de l’histoire d’une nation. La fiction, dans son acception la plus large, semble dans ce roman qui n’en est pas vraiment un, et avec puissance, le frère ennemi du mensonge : son alter ego radical.
La question générale de l’imposture prend, quoiqu’avec distanciation, voire avec ironie, une portée tragique ; en convoquant la figure de Narcisse, mais aussi celle de Don Quichotte, Cercas regarde son protagoniste, parfois, avec une compassion paradoxale, envisageant dans ce destin subsumé soudain dans le geste d’un mensonge tout ce qui peut sembler désespérant dans ces vies qui ne se réalisent pas, qui, selon la formule consacrée, passent à côté d’elles-mêmes. L’imposture en nous – dont Cercas se rend ouvertement coupable – celle-là même qui peut-être distingue le héros des autres, qui en tout cas falsifie la vérité au profit d’une justification mensongère, trouve dans ce livre un écho universel. Javier Cercas l’imposteur ? Le rapprochement, sur la couverture, du titre du livre et son auteur pourrait le suggérer. Mais s’il est une réflexion que sous-tend ce roman, ce serait peut-être, non la porosité qui agite la fiction et la réalité, mais bien la fiction et le mensonge. Si Enric Marco est un menteur, Javier Cercas est un auteur de fiction. Cercas, qui pousse loin la réflexion sur l’éthique de l’auteur, prend conscience que, si la fiction sauve et la réalité tue, alors ce qu’il entreprend court le risque de tuer celui dont il relate le mensonge, et avec lui peut-être une partie de l’histoire d’une nation. La fiction, dans son acception la plus large, semble dans ce roman qui n’en est pas vraiment un, et avec puissance, le frère ennemi du mensonge : son alter ego radical.
Est-ce tout ? N’y a-t-il plus de héros par là ? Un instant : et notre héros à nous ? Et Enric Marco ? Est-il juste un faux héros ? N’a-t-il jamais dit Non (ou du moins n’a-t-il pas essayé avant d’échouer) ? N’a-t-il jamais su pour toujours qui il est ? Ne peut-on pas être à la fois un faux héros et un héros véritable, un héros et un malfrat, de même que Don Quichotte à la fois ridicule et héroïque, ou fou et censé ? Est-il possible que le grand malfrat visible de ce livre soit en même temps son grand héros invisible ? (p. 366)







