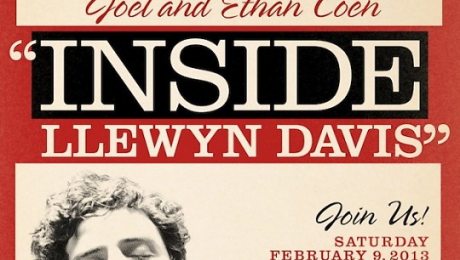Le nouveau film des frères Coen fait cinéma avec deux schèmes dominants de l’image contemporaine : le télé-crochet, qui relève de la télévision ; et la vidéo de chats-qui-font-des-trucs, laquelle relève plutôt d’internet.
Pour ce qui concerne le télé-crochet, on est prévenu d’emblée. La première séquence nous présente le visage humble, anonyme, d’un homme barbu qui interprète avec intensité une petite ballade folk, et son intensité est l’enjeu primordial de la scène, plus encore que la ballade, plutôt banale, appartenant au commun. C’est l’épreuve de transcendance à laquelle sont soumis les candidats d’un télé-crochet : à la première question « y a-t-il une voix ? » (question qui donne à la séquence son point de départ, mais qui ne justifie pas sa durée ni sa fixité, du moins en termes télévisuels), se substitue un plus ambigu « y a-t-il une âme ? », l’âme étant affaire, télévisuellement, de visage, de charisme, et d’émotion. Cela dit, la mise en scène de cette séquence est tout sauf télévisuelle : l’image reste extrêmement concentrée sur le visage du chanteur, les mouvements de caméra sont discrets, et les rares contrechamps ne présentent aucun public facilement identifiable, plutôt des silhouettes, des fumées de cigarettes, des postures à l’écoute. C’est une séquence à laquelle toute dramaturgie, toute codification a été ôtée : le spectateur ne participe pas à l’enthousiasme ou au rejet qui lui est présenté, il ne peut que douter de la qualité de la voix qu’il entend, du charisme du visage qui l’émet, de la qualité des émotions que la combinaison de cette âme et de ce charisme lui permet d’éprouver. Il est, littéralement, suspendu, à un jugement dont cette séquence semble encore vierge. Mais si le film démarre par une forme de pureté, bien vite l’impur reprendra ses droits. La suite du film fera office de jugement : le chanteur se prendra quelques coups de poing, n’aura plus d’argent, entendra les gens qu’il aime l’insulter, et aura très froid. Le scénario sera sévère et sans appel, et remplacera l’avis du jury.
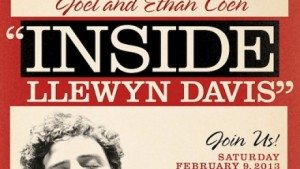
D’ailleurs, la seconde séquence de chant – celle, à Chicago, où le chanteur de folk vient présenter au patron d’une boîte un morceau de sa composition – est construite, quant à elle, selon la dramaturgie classique du télé-crochet. Le chanteur chante, face à un jury cette fois-ci, d’abord accompagné de sa guitare, puis a cappella (climax télévisuel), et, quand il se tait, le jury se prononce, sans que son visage, qui faisait office de contrechamp, ait laissé paraître la nature du jugement porté au sujet de ce qui vient d’être vu et entendu. Performance, puis évaluation.
Ces séquences chantées par le personnage principal – on en dénombre trois : une au début, une au milieu, une à la fin – sont les acmés du film, mises en valeur par d’autres séquences inspirées du même régime télévisuel, à savoir les candidats « casseroles » (les quatre pulls, la vieille moche, le boy scout), les chansons collectives (Justin Timberlake et Mister Kennedy), et l’éclosion d’une nouvelle star (Bob Dylan, encore méconnu, prenant le relai, sur la scène d’un bar miteux, de Llewyn Davis).
Entre elles se trouvent les séquences inspirées des vidéos de chats-qui-font-des-trucs, très populaires sur Youtube. Llewyn Davis, en effet, hérite par erreur d’un chat, le promène dans le métro, le perd, le retrouve, l’installe dans une voiture à côté d’un homme très gros qui dort, et l’abandonne, avant de l’écraser, par mégarde, sur le chemin du retour. Quelques scènes sont filmées à hauteur de chat. Quelques gros plans sur la tête de ce dernier le font participer aux ressorts scénaristiques de l’humanité telle qu’elle se met en scène. Le chat est le cœur émotionnel du film (plus encore que les enfants avortés, conçus par erreur, des deux femmes autour desquelles le chanteur semble avoir gravité, lesquels s’inscrivent plutôt dans le registre de la comédie ou du vaudeville), fantôme du compagnon disparu de Llewyn Davis, avec qui il chantait avant qu’il se suicide, événement ayant contraint Llewyn Davis à chanter seul, désormais. Or, au cinéma, le fantôme crée l’émotion, plus que ne le peuvent la performance ou l’esthétique – le fantôme fait que les images n’ont jamais l’air d’être tout à fait ce qu’elles sont, et dans cette dissension entre visible et invisible, présent et passé, situation et scénario, existence et essence, s’immiscent la possibilité d’une métamorphose abrupte et la mélancolie de cette métamorphose qui tarde à advenir. Se loge aussi l’anonymat : à la figure du chat, semblable entre toutes les figures de chats, répond celle de Llewyn Davis, semblable entre tous les chanteurs de folk qui crèvent de faim. C’est en cela que le choix de Oscar Isaac pour interpréter Llewyn Davis est plus que judicieux : on ne voit pas Brad Pitt ou George Clooney jouer avec un chat, on voit un acteur, dont le visage et le nom ne sont pas encore fixés dans nos mémoires de spectateurs, confronter son anonymat à celui, pérenne, du chat. Chat dont le nom, justement, échappe à Llewyn Davis. Et, lorsque celui-ci apprend qu’il s’appelle Ulysse, l’allusion mythologique compte moins que le fait que le chat est une légende se passant généralement de distinction (malgré quelques exceptions, Chat-Botté, Azraël, et autres Gros-Minet), de la même façon que le chanteur de folk en est une aussi. Etre un chanteur de folk, c’est être, de toute façon, Bob Dylan.
Toute la question du film, finalement, est de savoir ce qui lie le chant au chat, ou l’humain à l’animal. Sans emphase, sans surplomb, les Coen (qui pourtant ne sont pas avares en surplomb) font un film sur l’étrangeté des liens. Quelle était la relation de Llewyn Davis à son compagnon suicidé ? Amoureuse, amicale, fraternelle, purement artistique ? Domestique, peut-être ? Rien n’est élucidé. Il y a seulement le poids de cette perte, de ce compagnon qui n’est plus, et qui, par son absence, contraint la voix de Llewyn Davis à errer seule, de bar en bar, dans les rues froides des villes d’Amérique du Nord. C’est Sailor sans Lula, et les Coen n’ont jamais été aussi proches du cinéma de David Lynch, où l’absurde n’est pas appuyé, mais imposé, comme la condition indiscutable de l’existence terrestre. L’absurde est la rencontre, dont la signification n’est jamais donnée ; et c’est l’absurdité même, plus que l’amour, ou l’amitié, ou la fraternité, qui donne à la relation toute sa puissance émotionnelle. De même, on ne saura pas ce qui lie le gros joueur de jazz à son jeune chauffeur, lesquels prennent en stop Llewyn Davis sur la route de Chicago. Les liens échappent aux catégories. De leur nature, dans ce film, on ne discute pas. Place est faite à leur étrangeté, considérée avec une tendresse folle, et une crainte aussi : les liens sont périssables. Cet élément traverse le film avec d’autant plus de force qu’Inside Llewyn Davis est réalisé par deux frères qui travaillent ensemble depuis plus de vingt ans. On sent, à chaque image, une angoisse, celle de perdre l’autre, celle de vivre, comme Llewyn Davis, parmi les fantômes, celle d’avoir à exercer seul son art, un jour, peut-être, en compagnie d’images qui ne sont pas tout à fait ce qu’elles semblent être, de voix absentes, mais irremplaçables.
L’autre grande beauté du film est de nous donner à voir ce qu’était un artiste au début des années 50 ou 60, avant que les hippies ne viennent prendre le pouvoir, à savoir : un marginal. Quelqu’un que la société craint. Quelqu’un qui dans la société n’a pas encore de place clairement définie. Aussi la question de l’argent est-elle consubstantielle au destin des artistes : « Mes disques se vendent-ils ? » est tout sauf une question tabou, et donner à l’artiste de quoi se payer un manteau est le rôle du producteur. Etre artiste est un destin, pas une revendication. C’est un métier marginal, et pas un luxe partagé. Il y a là une pureté qu’aujourd’hui on peine à comprendre, une simplicité troublante, que les Coen mettent en lumière comme si l’heure était grave, comme si tout était déjà perdu.
La fin du film, très belle, qui rejoue la première séquence en la prolongeant, et nous laisse entrevoir l’éclosion de Bob Dylan tandis que Llewyn Davis s’achemine vers une contre-allée où il devrait se faire casser la gueule sans trop tarder, n’est pas qu’un truc, une boucle convenue, une manière facile et tape-à-l’œil de conclure quelque chose qui n’est allé nulle part. Ce que semblent nous dire les frères Coen, par cette fin, est que chaque concert (et, par conséquent, chaque film) est un recommencement, qui en lui-même contient le vœu d’un prolongement. Quelque chose de plus, à chaque concert (et à chaque film), est surmonté, même si tous les concerts (et tous les films) mènent au même endroit : l’oubli ; prennent le même risque : l’insignifiance. Mais au sein de cet oubli, et malgré l’insignifiance qui paraît fatale, peut émerger une figure : Bob Dylan par exemple, au frottement duquel une étincelle peut naître. Inside Llewyn Davisest l’histoire d’un chanteur de folk qui a croisé Bob Dylan.