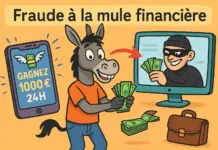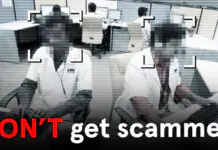La génération Z (née entre 1997 et 2010) est souvent considérée comme la première à être pleinement « digital native ». Pourtant, plusieurs études récentes soulignent sa vulnérabilité face à la désinformation, en particulier à travers les fake news circulant sur les réseaux sociaux (Pew Research Center, 2023; Stanford History Education Group, 2022). Cet article analyse les ressorts sociologiques et psychologiques de cette fragilité, en mobilisant les travaux sur la socialisation numérique, la cognition humaine, et la définition contemporaine de la vérité.
1. Une socialisation numérique ambivalente : compétence technique, fragilité critique
Contrairement à une idée reçue, la familiarité technique avec les outils numériques ne garantit pas une capacité à évaluer la fiabilité des sources d’information. La génération Z a développé un rapport utilitaire et ludique aux réseaux sociaux, sans toujours acquérir les compétences critiques associées à l’analyse des contenus (Mihailidis & Viotty, 2017).
La notion de « capital informationnel critique » (inspirée de Bourdieu, 1979) désigne cette capacité à détecter les biais, à vérifier les sources, à contextualiser une information. Or, les jeunes issus de milieux peu dotés en capital culturel tendent à être plus vulnérables à la désinformation (Guess, Nagler, & Tucker, 2019).
2. Surcharge cognitive et recours aux heuristiques mentales
Les réseaux sociaux imposent un environnement d’énorme surcharge informationnelle (Eppler & Mengis, 2004), forçant les utilisateurs à recourir à des heuristiques, ou raccourcis cognitifs (Tversky & Kahneman, 1974).
Par exemple, l’heuristique de la popularité (« si beaucoup de personnes partagent, cela doit être vrai ») et celle de la familiarité (« j’ai déjà vu passer cela, donc c’est crédible ») sont massivement activées. Pennycook et Rand (2019) montrent que le jugement intuitif prime sur la réflexion analytique dans la consommation rapide de contenus numériques.
3. La mutation contemporaine du rapport à la vérité
Depuis les années 2000, plusieurs auteurs observent un glissement vers une conception relativiste de la vérité, renforcée par la « post-vérité » (Keyes, 2004; McIntyre, 2018). Dans ce contexte, la vérité devient subjective, multiple, dépendante des communautés d’appartenance.
La génération Z, exposée à cette fragmentation épistémique, est amenée à privilégier des récits qui correspondent à ses identités sociales et à ses émotions, au détriment de la vérification objective.
4. Les fake news comme réponses aux besoins affectifs et identitaires
Les travaux de Frenda et al. (2011) et de Lewandowsky et al. (2012) montrent que les fake news fonctionnent comme des objets affectifs : elles renforcent l’appartenance à un groupe, confortent les croyances existantes, réduisent l’anxiété face à l’incertitude.
Pour une jeunesse souvent en quête de stabilité identitaire (Erikson, 1968) dans un monde perçu comme chaotique (crises climatiques, économiques, politiques), ces récits simplificateurs offrent une sécurité cognitive et émotionnelle.
5. Des dynamiques de résistance et d’éducation critique
Il serait toutefois réducteur de ne voir la génération Z que comme victime passive. De nombreuses initiatives, notamment dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), visent à renforcer les compétences critiques (Wineburg et McGrew, 2017).
En outre, certains jeunes s’organisent en collectifs de fact-checking ou participent à des mouvements de vérification collaborative sur les plateformes. Ces pratiques illustrent une résilience active face à l’environnement informationnel toxique.
6. Dangers et évolutions possibles : vers la défiance ou la responsabilisation ?
La situation psychologique de la génération Z face aux fake news comporte des risques notables. Une exposition prolongée à la désinformation peut générer une perte de confiance généralisée envers les institutions, les médias et même la science, menant à des attitudes cyniques, voire complotistes. Par ailleurs, la confusion informationnelle chronique pourrait accroître les niveaux d’anxiété et de détresse cognitive (Fischer et al., 2020).
Toutefois, des évolutions positives sont également envisageables : si une éducation critique est réellement diffusée et valorisée, cette génération pourrait devenir l’une des plus conscientes et réflexives en matière d’information, capable de reconstruire de nouveaux modèles de vérification participative et d’éthique numérique.
La supposée crédulité de la génération Z face aux fake news doit être comprise comme le produit d’interactions complexes entre socialisation numérique, charges cognitives, évolution des rapports à la vérité et dynamiques identitaires. Plutôt que de stigmatiser cette génération, l’enjeu est d’accompagner le développement de ses capacités critiques afin de favoriser une citoyenneté éclairée dans l’écosystème numérique contemporain.
Toutefois, il convient de souligner que cette évolution positive est conditionnée par le déploiement effectif de moyens financiers, pédagogiques et institutionnels importants pour généraliser l’éducation à l’esprit critique et au discernement numérique. La réduction des budgets alloués à la prévention et l’érosion du pluralisme critique, en particulier dans les médias français, n’y contribuent guère.
Bibliographie
- Bourdieu, P. (1979). La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Les Éditions de Minuit.
- Eppler, M. J., & Mengis, J. (2004). The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines. The Information Society, 20(5), 325-344.
- Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton.
- Fischer, P., Greitemeyer, T., Kastenmüller, A., Jonas, E., & Frey, D. (2020). Threat and Cognitive Functioning: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 146(6), 472-503.
- Frenda, S. J., Knowles, E. D., Saletan, W., & Loftus, E. F. (2011). False memories of fabricated political events. Journal of Experimental Social Psychology, 47(5), 1003-1008.
- Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. Science Advances, 5(1), eaau4586.
- Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. New York: St. Martin’s Press.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing. Psychological Science in the Public Interest, 13(3), 106-131.
- McIntyre, L. (2018). Post-Truth. Cambridge, MA: MIT Press.
- Mihailidis, P., & Viotty, S. (2017). Spreadable spectacle in digital culture: Civic expression, fake news, and the role of media literacies in \ »post-fact\ » society. American Behavioral Scientist, 61(4), 441-454.
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. Cognition, 188, 39-50.
- Stanford History Education Group. (2022). Civic Online Reasoning: A National Portrait. Stanford University.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), 1124-1131.
- Wineburg, S., & McGrew, S. (2017). Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information. Stanford History Education Group.